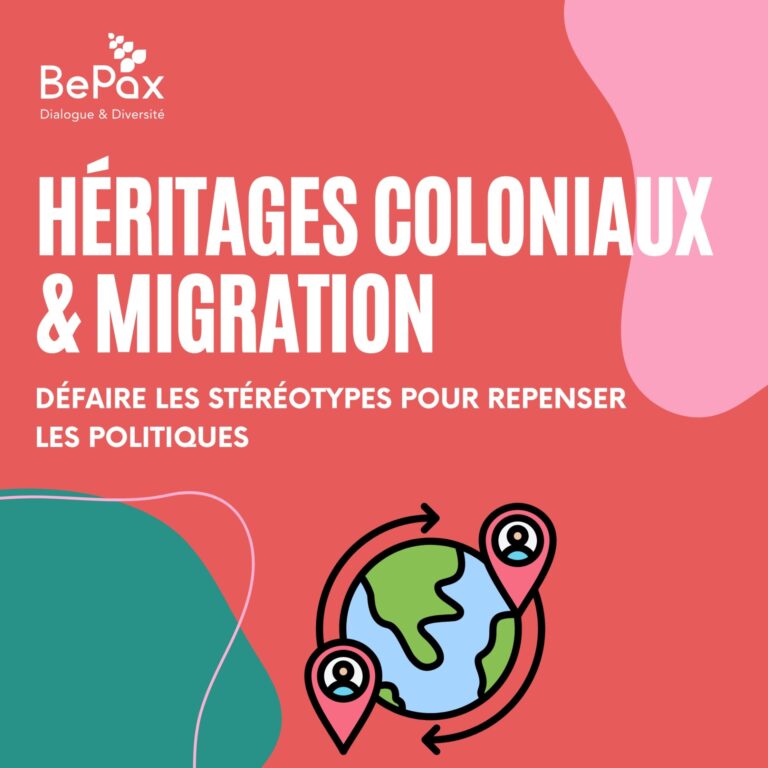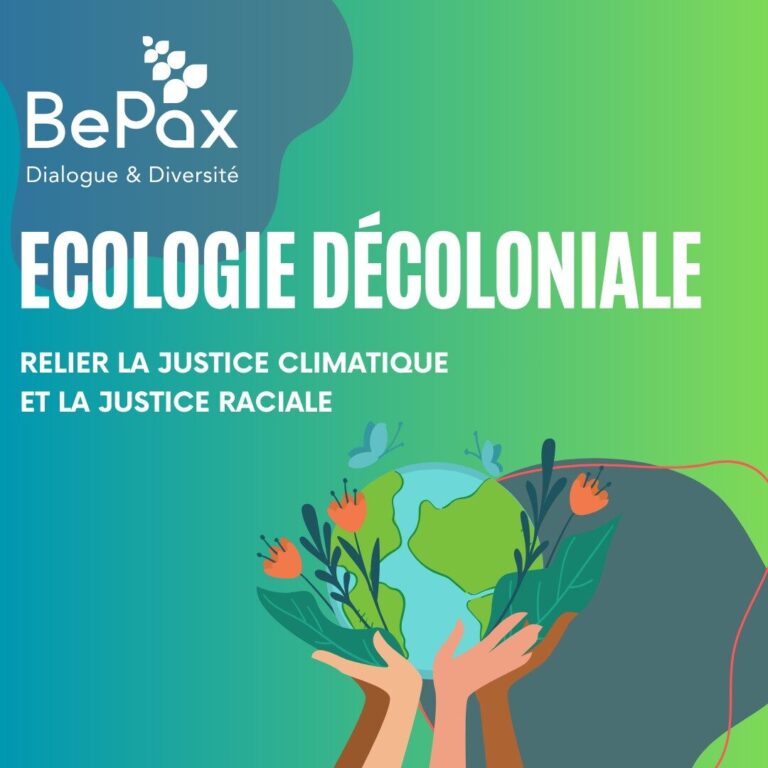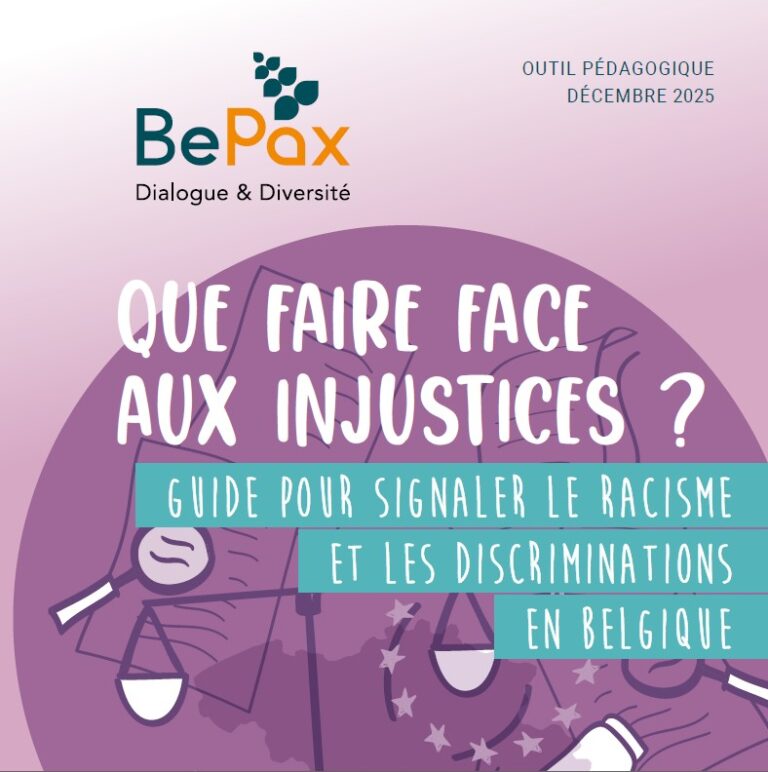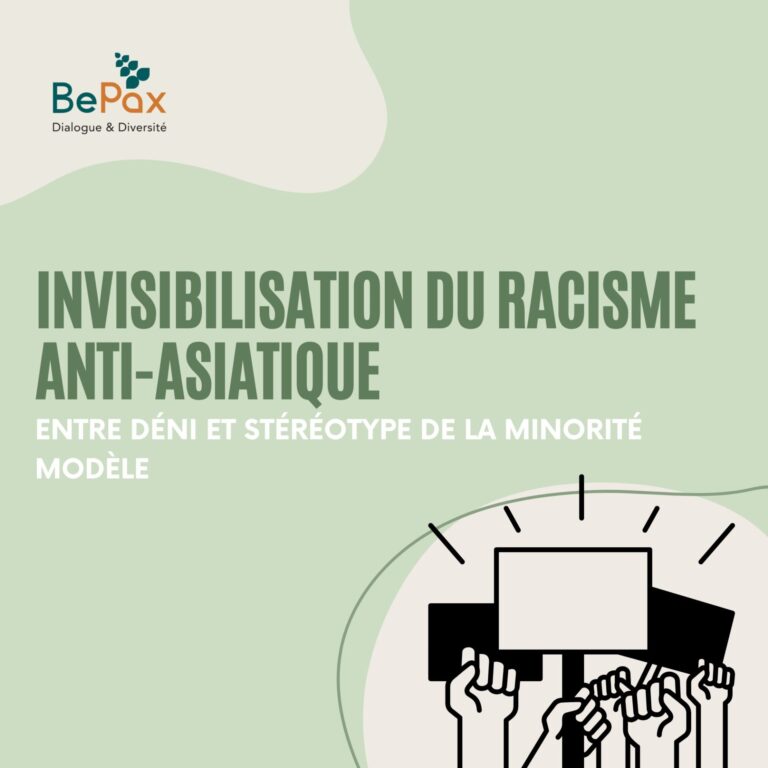Cette analyse explore les liens historiques entre l’héritage colonial, le racisme systémique et les dynamiques migratoires contemporaines en Belgique. En adoptant une perspective décoloniale, elle met en lumière l’influence durable des pratiques coloniales sur les lois, perceptions et discours actuels des migrations. Le texte propose une réflexion critique sur les stéréotypes, le racisme structurel et les approches politiques pour construire des politiques migratoires plus inclusives et historiquement informées.
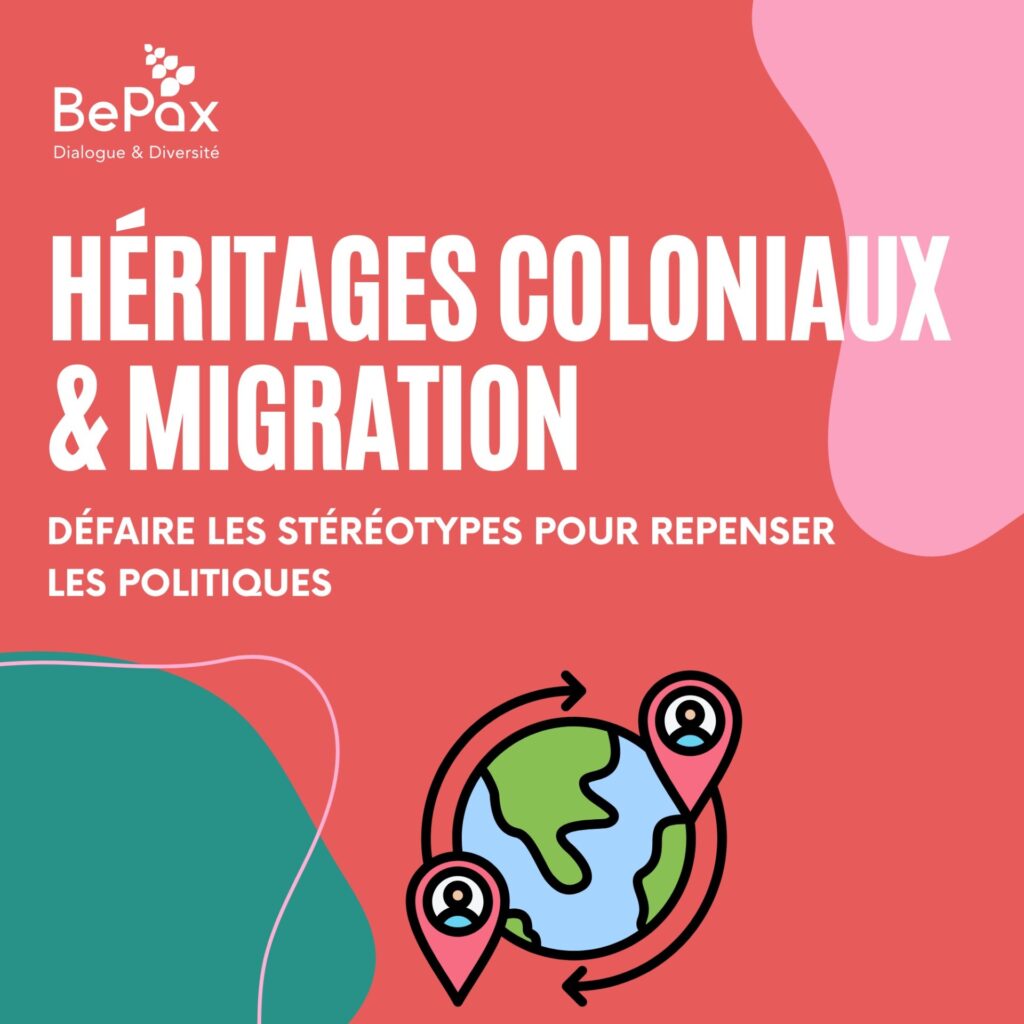
Les migrations sont souvent perçues comme des phénomènes récents, nées de crises contemporaines ou de besoins économiques immédiats. Pourtant, réduire ces dynamiques à une simple lecture du présent, c’est ignorer des siècles d’Histoire qui continuent de façonner nos réalités. Deux dimensions essentielles restent largement sous-explorées dans les analyses migratoires : l’héritage de l’histoire coloniale et le rôle du concept de prétendue « race »[1]. Ces éléments, pourtant centraux, permettent de mieux comprendre pourquoi et comment les politiques migratoires actuelles se sont construites.
Adopter une perspective décoloniale ne consiste pas seulement à éclairer le passé, mais permet également de révéler comment celui-ci continue d’influencer les lois, les discours et les représentations liés aux migrations. Cette analyse vise à mettre en lumière cette continuité coloniale et à souligner son importance pour repenser le phénomène migratoire en Belgique avec une profondeur historique et critique.
Racisme et mobilité : des racines historiques profondes
Le racisme trouve ses racines dans l’histoire de l’esclavage transatlantique, un système qui a marqué des millions de vies par le déplacement forcé et l’exploitation des personnes esclavagées. Ce système, profondément ancré dans les logiques de domination et de profit, a progressivement conduit à l’élaboration de discours religieux, philosophiques et scientifiques destinés à justifier la hiérarchisation des populations humaines. À l’époque des Lumières, ces discours ont pris la forme de théories pseudo-scientifiques sur la prétendue « race », renforçant l’idée que certaines populations étaient inférieures par nature.[2] Ces constructions idéologiques ont non seulement légitimé la traite des personnes esclavagées mais aussi influencé durablement les perceptions et les pratiques liées à la mobilité humaine.[3] Au 19ᵉ siècle, l’expansion coloniale belge au Congo (colonisé d’abord comme propriété personnelle du roi Léopold II de 1885 à 1908, puis comme colonie de l’État belge jusqu’en 1960)[4] et au Ruanda-Urundi (1916-1962) [5] constituait une occupation qui engendra une forme de mouvement des colons vers le pays. Ainsi, le concept de race a influencé dès le départ la mobilité des populations, que ce soit celles des personnes mises en esclavage et déportées de force ; ou la mobilité de populations colonisatrices s’installant en territoires étrangers.[6] Ces mouvements migratoires, tout comme les frontières qu’ils impliquaient, étaient profondément marqués par des logiques racistes : qui pouvait se déplacer, quand et où, ces éléments étaient déterminés par les empires coloniaux.
Par la suite, entre 1950 et 1980, des migrations industrielles, principalement en provenance de l’Italie, du Maroc et de la Turquie, vers la Belgique ont eu lieu car le pays avait besoin de main d’oeuvre[7]. Le débat sur les politiques migratoires belges était dès lors très fortement concentré sur les droits des travailleurs et le regroupement familial. Dans le même temps, une migration congolaise existait déjà, mais elle était principalement limitée aux élites et aux étudiant·es, dont les arrivées étaient strictement encadrées. Par la suite, l’arrivée des personnes sans-papiers et leur régularisation a pris une place centrale dans les années 90. C’est également à cette période que la présence des diasporas congolaises et rwandaises a largement augmenté sur le territoire belge, notamment en tant que réfugié·es politiques. En effet, contrairement à ses pays voisins, la Belgique n’a pas facilité ni permis une migration de ses anciennes colonies.[8] Cette différence s’explique par la stratégie belge visant à limiter l’arrivée de populations issues des anciennes colonies pour maintenir un contrôle politique et économique sur ces territoires tout en préservant une certaine distance culturelle et sociale avec les colonisé·e·s. Suite à leur arrivée, les diasporas des Grands Lacs[9] ont suscité des débats sur la décolonisation en Belgique, mettant en lumière la nécessité de transformer les mentalités, les institutions et les processus hérités du passé colonial.
La colonisation a beau être terminée, elle a laissé des traces, et notamment ce que nous appelons la colonialité, c’est-à-dire : les attitudes, comportements et structures hérités de la colonisation, qui continuent d’influencer des imaginaires et les représentations que la société se fait de personnes issues des ex-colonies.[10]
Les études migratoires ont eu tendance à oublier le racisme postcolonial[11] et la racialisation[12], et promeuvent plutôt une compréhension de la migration déconnectée de son historicité. [13] [14] Comprendre les migrations comme une conséquence de la racialisation historique de la mobilité est crucial pour aborder ce phénomène de manière éclairée.
Belgique et migrations : une continuité politique
En Belgique, l’histoire coloniale a laissé une double empreinte durable sur le contexte migratoire actuel : une continuité au sein des institutions politiques et une continuité dans les représentations sociales. Ces deux dimensions s’entrelacent pour structurer la manière dont les migrations sont perçues et gérées.
D’un point de vue des politiques de mobilité, les mécanismes mis en place durant la colonisation ont été adaptés aux structures contemporaines. L’administration coloniale belge exerçait un contrôle strict sur les déplacements des Congolais·e·s. Les autorités imposaient des restrictions sur les migrations internes, notamment en réglementant les mouvements des travailleur·euse·s entre les zones rurales et urbaines. Un système de laissez-passer et de permis de travail était mis en place pour surveiller et limiter les déplacements des individus. En ce qui concerne les voyages vers la « métropole », l’émigration congolaise était fortement restreinte. Seules quelques personnes, souvent des étudiant·e·s ou des membres de l’élite, obtenaient l’autorisation de se rendre en Belgique, et leurs activités étaient étroitement surveillées.[15] Un autre exemple de contrôle sur les mouvements est la relégation, c’est-à-dire la déportation qu’encourait tout habitant « indigène » de la Colonie qui compromettait la tranquillité publique. La relégation faisait partie des sanctions décidées uniquement par l’administration coloniale. Aujourd’hui, l’Office des étrangers conserve des pratiques similaires, notamment l’usage de bases de données pour surveiller les mouvements migratoires.
Les politiques coloniales ont également façonné des visions spécifiques de l’intégration. Dans les colonies, les écoles missionnaires imposaient les valeurs belges, le christianisme, et l’apprentissage du français ou du néerlandais, au détriment des identités locales[16]. Ces approches assimilationnistes se retrouvent aujourd’hui dans certains parcours d’intégration. En Flandre, par exemple, il existe un cours sur l’apprentissage des normes et valeurs culturelles.[17] Bien que le processus d’intégration soit obligatoire dans chaque région et devient de plus en plus restrictif, tous les nouveaux·elles arrivant·e·s ne sont pas obligé·e·s de passer par ce processus. Les membres de l’Union européenne et les Ukrainien·ne·s, par exemple, en sont dispensés.[18] Ce traitement différencié reflète une hiérarchisation implicite des populations migrantes, où celles issues de contextes occidentaux ou perçues comme culturellement proches bénéficient d’un accès facilité, tandis que les autres, souvent associées à des pays non-européens et/ou anciennement colonisés, font face à des exigences d’assimilation plus lourdes. Cette distinction renforce les inégalités structurelles et perpétue des préjugés sur la supposée « compatibilité culturelle » des personnes migrantes.
Le contrôle des populations colonisées constituait une autre caractéristique marquante de l’administration coloniale.[19] Ces pratiques répressives se manifestent encore dans les politiques migratoires actuelles, où une forte attention est portée à la surveillance des personnes migrantes[20], notamment celles provenant des anciennes colonies. Les dispositifs de contrôle mettent souvent en avant des logiques sécuritaires qui reproduisent des dynamiques de pouvoir héritées de la période coloniale.
Une continuité coloniale dans les représentations
Les représentations sociales sont également imprégnées des stéréotypes[21] raciaux qui étaient au cœur de l’idéologie coloniale. Ces stéréotypes construisent des images péjoratives des migrant·e·s issu·e·s des anciennes colonies, qui sont perçu·e·s comme moins qualifié·e·s ou moins aptes à s’intégrer[22]. Les compétences et les diplômes obtenus dans des pays hors de l’Europe sont souvent dévalorisés, entraînant un déclassement professionnel[23]. D’autres préjugés, tels que l’idée que les migrant·e·s sont « paresseux·euses » ou qu’iels viennent « profiter du système »[24], reflètent les discours sur la prétendue incapacité des peuples anciennement colonisés à adopter une discipline de travail. Ces perceptions biaisées masquent pourtant le rôle crucial des personnes migrantes, notamment sans-papiers, dans le fonctionnement de nombreux secteurs en Belgique tels que le personnel de maison, le bâtiment, le nettoyage et l’Horeca.[25]
Par ailleurs, les représentations héritées du colonialisme continuent d’associer certaines communautés à la criminalité et à la violence,[26] alimentant des discours sécuritaires et des politiques discriminatoires. La culture des personnes migrantes est souvent perçue comme inférieure ou incompatible avec les « valeurs européennes »[27]. Cette dévalorisation culturelle est particulièrement visible dans les discours sur les « normes » et les « coutumes » des migrant·e·s, qui seraient en opposition avec les standards de la société belge. Enfin, dernier exemple, les femmes migrantes subissent une double stigmatisation : elles sont à la fois infantilisées, considérées comme vulnérables ou soumises, et sexualisées, perpétuant ainsi les fantasmes construits à l’époque coloniale[28].
Agir pour une justice migratoire décoloniale
Pour transformer en profondeur les politiques migratoires et les perceptions qui les entourent, il est important d’adopter une approche historique et critique. Les migrations doivent être placées dans leur contexte historique afin de comprendre leur lien intrinsèque avec le colonialisme et la racialisation. Les politiques migratoires, souvent pensées en termes économiques ou sécuritaires, doivent être examinées sous un prisme décolonial, en intégrant les conséquences des inégalités produites par l’histoire coloniale et impérialiste. Prendre en considération cette histoire amène également à une meilleure reconnaissance et compréhension du racisme comme système.[29]
Une réflexion décoloniale implique notamment de se défaire des postures paternalistes et de reconnaître le rôle central des personnes migrantes dans leurs propres luttes. Les initiatives visant à défendre leurs droits doivent placer les personnes concernées au cœur des décisions et des revendications. Cela signifie notamment inclure les personnes sans-papiers dans les plaidoyers politiques antiracistes, pour garantir une lutte réellement inclusive.
Enfin, une critique efficace des politiques migratoires passe par la conscientisation des mécanismes de colonialité qui structurent encore les dynamiques internationales de mobilité. Il est indispensable de penser les migrations comme un phénomène global influencé par les rapports de pouvoir hérités du colonialisme. En Belgique, cela nécessite de déconstruire les stéréotypes et les préjugés qui pèsent sur les personnes migrantes, tout en valorisant leurs savoirs, leurs compétences et leurs identités.
En somme, agir dans le domaine migratoire ne peut se faire sans une prise de conscience historique et une remise en question profonde des structures héritées du colonialisme. C’est en adoptant cette posture que l’on pourra construire des politiques plus justes, inclusives et respectueuses.
Autrice : Fariha Ali.
Comité de rédaction : Noelle Aboya et Laura Ganza.
[1] Le terme « prétendue race » ou « race sociale » est utilisé pour souligner que la race n’a aucune base scientifique ou biologique, mais qu’elle demeure une construction sociale et historique. Ce concept reflète les divisions artificiellement créées pour justifier des hiérarchies et des discriminations, notamment durant la période coloniale. Pour aller plus loin : « Le racisme comme système : « Racisée » ? « Racisation » ? « Racialisée » ? « Racialisation » ? » par Nour Outojane, 2021.
[2] Le Bras, H. (2017). Courte histoire des idées racistes. In Antiracistes (pp. 119-130). Robert Laffont.
[3] Mayblin, L., & Turner, J. (2020). Migration studies and colonialism. John Wiley & Sons.
[4] Reybrouck, D. V. (2012). Congo, Une histoire. Éditions Actes Sud.
[5] Reyntjens, F. (2021). Le genocide des Tutsi Au Rwanda. QUE SAIS-JE.
[6] Mayblin, L., & Turner, J. (2020). Race and Racism in international migration. In Migration studies and colonialism. John Wiley & Sons.
[7] Martiniello, M., & Rea, A. (2024). Une brève histoire de l’immigration en Belgique. Fédération Wallonie Bruxelles. https://www.fass.uliege.be/cms/c_11976180/fr/une-breve-histoire-de-l-immigration-en-belgique
[8] Fadil, N., & Martiniello, M. (2020). Racisme et antiracisme en Belgique. Fédéralisme 2034-6298, 20(2020).
[9] Les pays des Grands Lacs désignent une région d’Afrique de l’Est centrée autour des grands lacs africains, comme le lac Victoria, le lac Tanganyika et le lac Kivu. Cette région inclut notamment le Burundi, le Rwanda, l’Ouganda, et parfois la République démocratique du Congo, en raison de leurs liens géographiques, historiques et culturels.
[10] Feministe toi-même. (2022). Les mots du contre-pouvoir: Petit dico féministe, antiraciste et militant. Editions Academia.
[11] Le racisme postcolonial désigne les dynamiques de discrimination, de stigmatisation et d’exclusion fondées sur l’origine, la prétendue race ou la culture, qui trouvent leurs racines dans l’histoire coloniale. Ces formes de racisme s’inscrivent dans des structures sociales, politiques et économiques héritées de la période coloniale, influençant encore aujourd’hui les rapports de pouvoir et les représentations. Elles perpétuent des stéréotypes et des logiques de domination, malgré l’abolition officielle des systèmes coloniaux. Pour aller plus loin, voir l’article « Un racisme post-colonial » publié sur le site Les Mots Sont Importants.
[12] La racialisation ou racisation (voir C. Guillaumin, L’idéologie raciste [1972], Paris, Gallimard, 2002) est un processus d’altérisation et de minorisation qui consiste à expliquer un phénomène social (par exemple la violence) par les caractéristiques naturalisées telles que l’appartenance nationale, culturelle, religieuse, l’origine, la prétendue race ou la couleur de la peau. Lors de ce processus, le groupe subissant la racialisation est dit « racisé » et le groupe agent du processus est dit « racisant. » Ces termes ont été développés par Colette Guillaumin en 1972 et sont approfondis dans notre analyse « Le racisme comme système : « Racisée » ? « Racisation » ? « Racialisée » ? « Racialisation » ? » par Nour Outojane, 2021.
[13] Mayblin, L., & Turner, J. (2020). Race and Racism in international migration. In Migration studies and colonialism. John Wiley & Sons.
[14] Spivak, G. C. (1999). A critique of postcolonial reason: Toward a history of the vanishing present. Harvard University Press.
[15] Chambre des représentants de Belgique. (2021). Commission spéciale chargée d’examiner l’État indépendant du Congo et le passé colonial de la Belgique au Congo, au Rwanda et au Burundi, ses conséquences et les suites qu’il convient d’y réserver : rapport des experts(Doc. 55 1462/002).
[16] Depaepe, M., & Angotako Mawanzo, D. (2021, August 31). L’éducation coloniale au Congo belge. Encyclopédie d’histoire numérique de l’Europe. Retrieved November 19, 2024
[17] Adam, I., & Martiniello, M. (2013). Divergences et convergences des politiques d’intégration dans la Belgique multinationale. Le cas des parcours d’intégration pour Les immigrés. Revue européenne des migrations internationales, 29(2), 77-93.
[18] Borissov, P., Saldi, M., & Dechamps, A. (2024, April 26). Parcours d’intégration en Belgique : Un pays, trois visions. Latitudes – FR. https://medialatitudes.be/parcours-daccueil-en-belgique-une-integration-divisee/
[19] Lauro, A. (2011). Maintenir l’ordre dans la Colonie-modèle. Notes sur les désordres urbains et la police des frontières raciales au Congo Belge (1918-1945). Crime, Histoire & Sociétés, 15(2), 97-121.
[20] Maurel, C. (2025, January 6). Frontex, 20 ans de surveillance répressive des frontières européennes. The Conversation.
[21] Un stéréotype est défini comme une croyance généralisée concernant les attributs, caractéristiques, comportements ou traits de personnalité attribués à un groupe social particulier. Voir : Azzi, A. E., & Klein, O. (1998). Chapitre 1 : Stéréotypes et relations intergroupes. In Psychologie sociale et relations intergroupes (2013 ed., pp. 11-36).
[22] Seul 1 Belge sur 5 estime que les populations d’origine étrangère sont bien intégrées. Par contre, plus de 4 Belges sur 10 jugent qu’elles sont mal intégrées. Voir : Bo., S. (2013, June 3). L’intégration? Un échec pensent les Belges. La Libre.be.
[23] Poisson, C. (2024, August 30). Du déni des compétences comme gaspillage à l’auto-emploi comme résilience. IRFAM.
[24] Ouali, N. (2022). Welfare state and the hunt for “Social benefit cheaters and profiteers” migrants: The case of Belgium. Marx, Engels, and Marxisms, 63-89.
[25] Fairwork. (2022). Travailleurs sans papiers, rapport annuel 2022. Workers – Fairwork Belgium.
[26] Près de sept Belges sur dix (66 %) estiment que les immigrés accentuent les problèmes de criminalité au niveau national. Wallons (66 %) et Flamands (67 %) partagent cette opinion alors qu’une proportion relativement plus faible de Bruxellois (58 %) y souscrit. Voir Lafleur, J., & Marfouk, A. (2017). Pourquoi l’immigration?: 21 questions que se posent les Belges sur les migrations internationales Au XXIe siècle. Academia/L’Harmattan.
[27] 25 % des Belges pensent que les immigrés appauvrissent la vie culturelle en Belgique. Les Wallons (27 %) et les Flamands (25 %) sont plus fréquemment de cet avis que les Bruxellois (15 %). Voir Lafleur, J., & Marfouk, A. (2017). Pourquoi l’immigration?: 21 questions que se posent les Belges sur les migrations internationales Au XXIe siècle. Academia/L’Harmattan.
[28] Blanchard, P., Bancel, N., Boëtsch, G., Thomas, D., & Taraud, C. (2018). Sexe, race & colonies. La domination des corps du XVe siècle à nos jours. La découverte.
[29] Bonam, C. M., Nair Das, V., Coleman, B. R., & Salter, P. (2018). Ignoring history, denying racism: Mounting evidence for the Marley hypothesis and Epistemologies of Ignorance. Social Psychological and Personality Science, 10(2), 257-265.