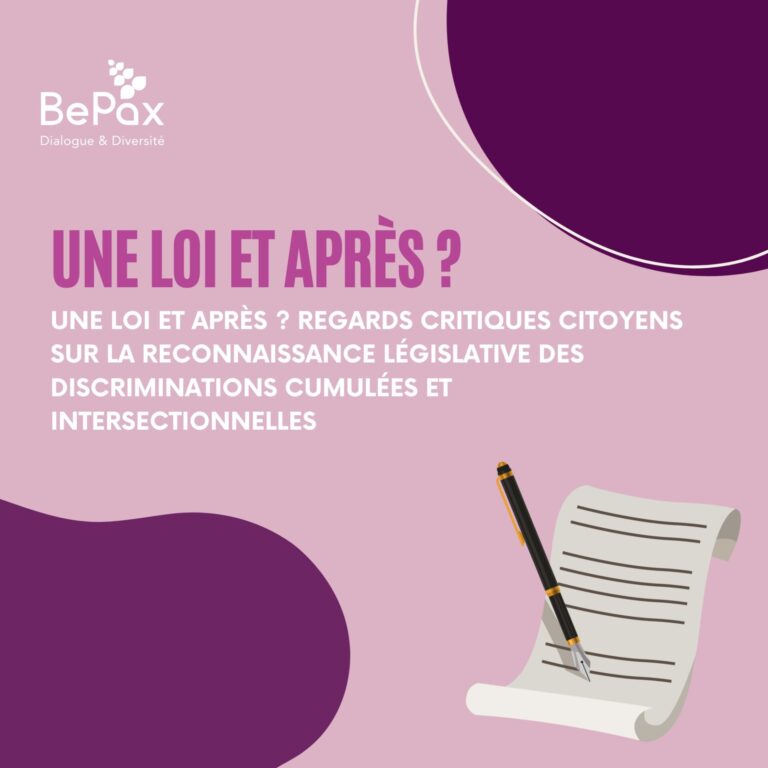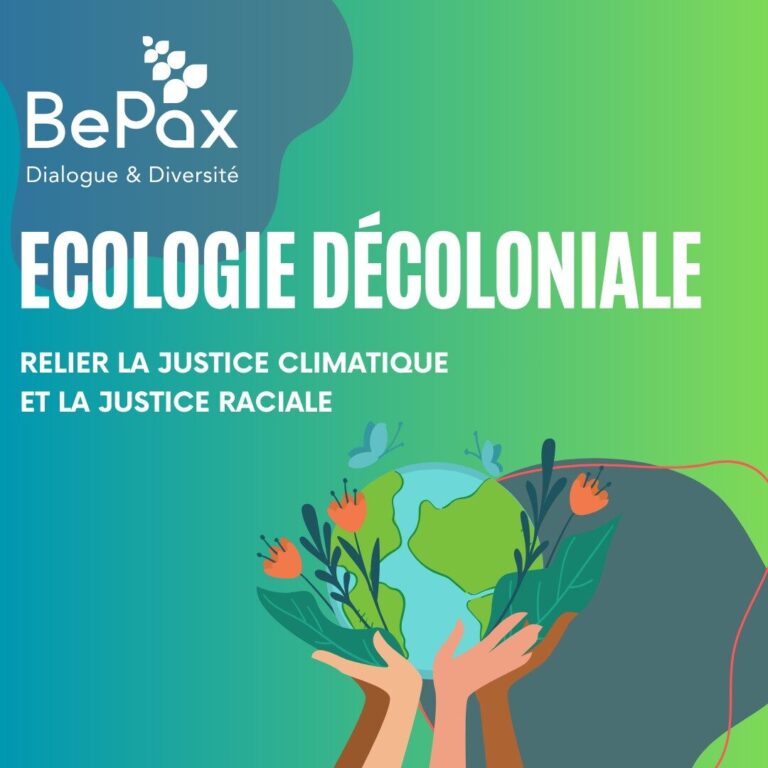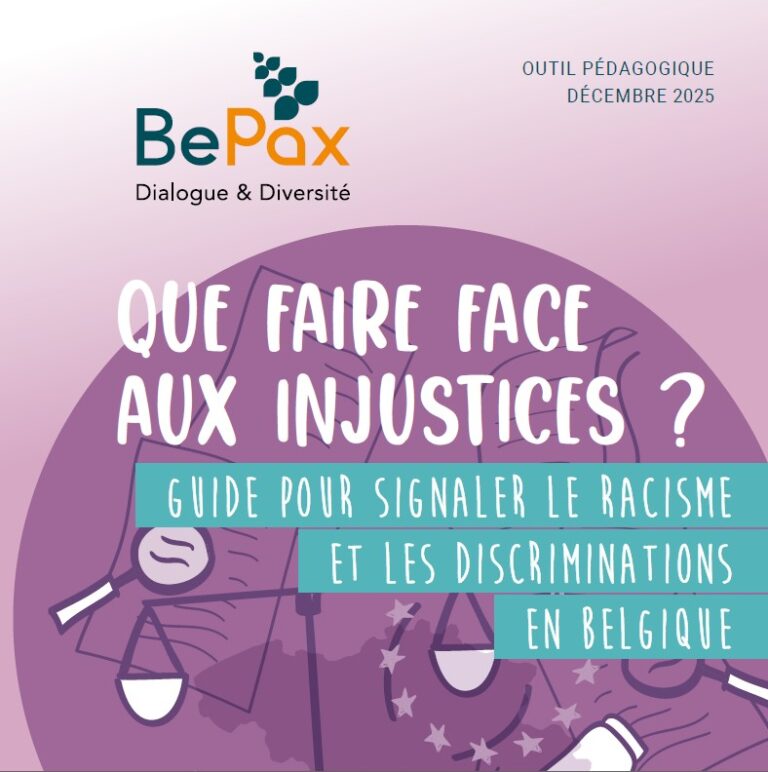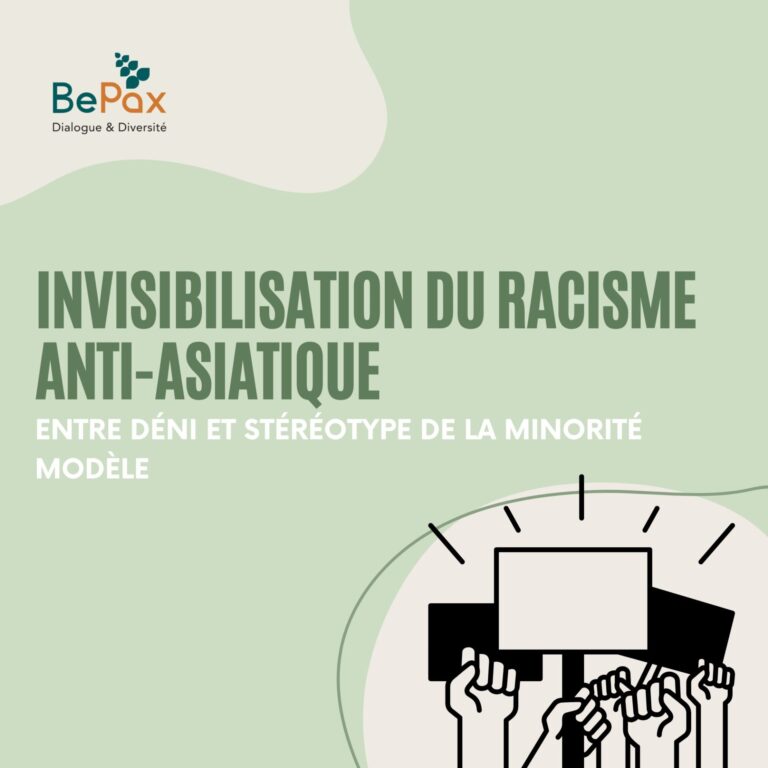Retour sur l’évolution du concept
L’intersectionnalité est une notion issue des théories des féministes noires américaines des années 70, et plus particulièrement des travaux de Kimberlé W. Crenshaw. Au travers de l’analyse de différentes affaires de discrimination à caractère raciste et sexiste, la juriste a voulu démontrer que les discriminations que peuvent vivre les femmes noires sont différentes de celles que vivent les hommes noirs d’une part, et les injustices qui touchent les femmes blanches d’autre part. Crenshaw montre ainsi que les femmes noires peuvent être ciblées par le sexisme et le racisme de manière simultanée et unique. Le croisement de ces critères conduit dès lors à la création d’une nouvelle forme de discrimination bien spécifique à ce groupe social.
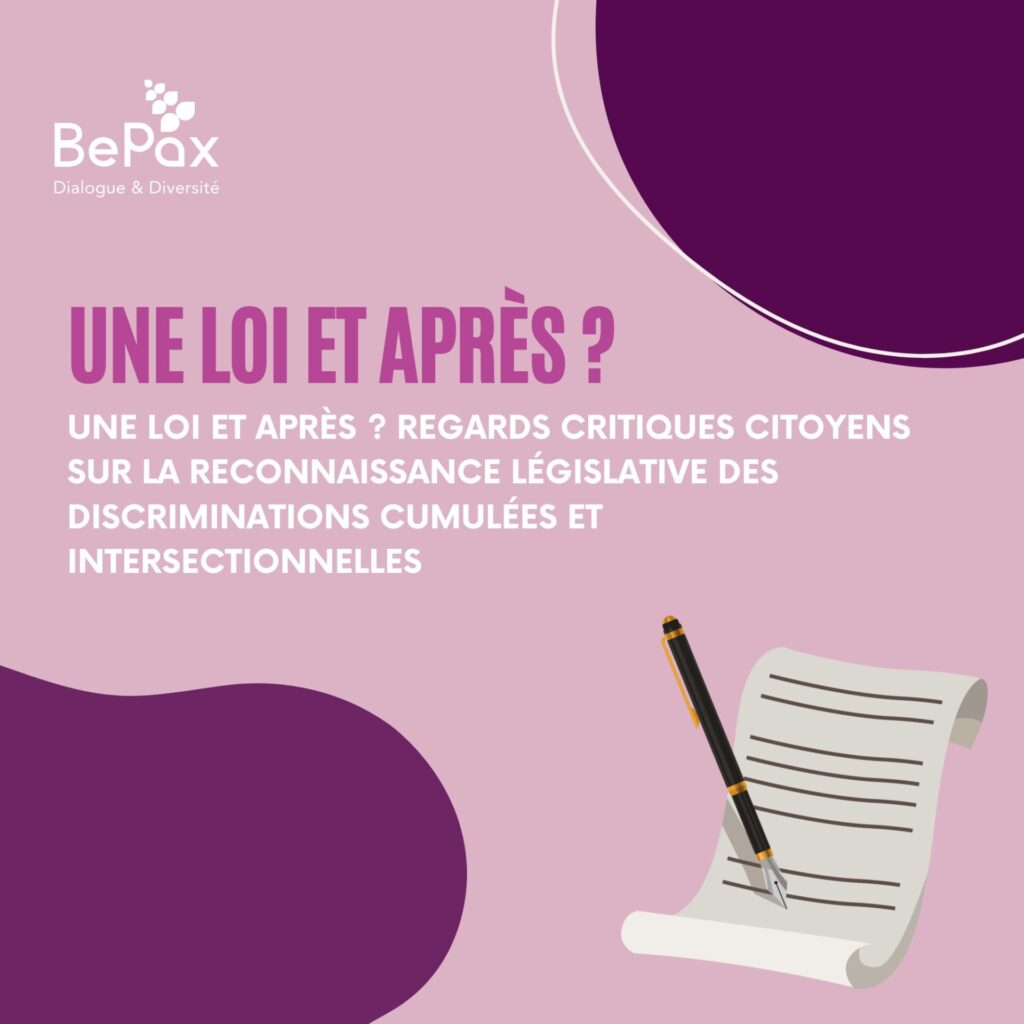
Après un essor outre-Atlantique dans les années 80 et 90, l’intersectionnalité est arrivée dans les milieux militants belges et français au début des années 2010. À la suite de plusieurs années de revendications émanant d’associations de lutte contre les inégalités, le Parlement fédéral a approuvé, en juin 2023, un projet de loi qui intègre l’idée de discrimination multiple. La législation établit dorénavant ce principe par deux biais : la discrimination cumulée et la discrimination intersectionnelle. La discrimination cumulée évoque une discrimination fondée sur plusieurs critères protégés qui s’additionnent mais restent dissociables. La discrimination intersectionnelle, quant à elle, est la résultante d’une discrimination sur plusieurs critères protégés qui interagissent et deviennent indissociables. S’appuyant donc sur plusieurs critères qui ne peuvent être analysés de manière distincte, une discrimination intersectionnelle crée des effets spécifiques et uniques. Elle n’est donc pas une addition de plusieurs discriminations, comme l’est la discrimination cumulée, mais une forme de discrimination bien particulière.
Un couple de femmes souhaite louer un appartement mais se voit refuser de nombreuses visites en raison de leur genre et de leur orientation sexuelle.
- Discrimination cumulée : Ce couple de femmes subit une forme de discrimination cumulée (genre et orientation sexuelle) dans la mesure où une femme seule ou un couple d’hommes voulant louer un appartement pourrait également se voir refuser une visite. Le critère du genre et celui de l’orientation sexuelle peuvent donc être dissociés puisque dans la même situation, les individus pourraient être discriminés pour un seul de ces deux critères de manière isolée.
Lors d’une sortie, des jeunes hommes perçus comme noirs et maghrébins se voient refuser l’entrée dans une boîte de nuit.
- Discrimination intersectionnelle : Ce groupe de jeunes hommes subit une discrimination intersectionnelle en raison de leur genre et leur prétendue « race ». Nous pouvons dire que ces deux critères sont indissociables car les jeunes hommes perçus comme « blancs » n’auraient aucun problème à entrer dans la boîte de nuit, et de même pour les femmes perçues comme noires ou maghrébines. C’est donc bien en raison de la combinaison de leur genre et leur prétendue « race » (et des stéréotypes qui y sont associés) que ces jeunes hommes n’ont pas accès à la discothèque. Ces deux critères sont dès lors indissociables.
La reconnaissance des discriminations cumulées et intersectionnelles devrait, en théorie, avoir pour conséquence une plus grande protection contre les discriminations puisque cet élargissement permet de considérer des situations particulières qui passaient auparavant sous les radars. Bien que cette avancée soit à souligner, le groupe de réflexion et d’action sur l’intersectionnalité de BePax émet certaines critiques et souligne les limites de cette réforme.
Un pas (timide) en avant
La singularité d’une personne émane du croisement de différents marqueurs d’identités : son âge, son genre, sa prétendue racialité, son orientation sexuelle, ses convictions politiques, … Ces identités plurielles impliquent que certaines situations doivent être analysées avec plusieurs lunettes (en lien avec le genre, la prétendue « race », la religion, l’orientation sexuelle, le handicap, …). Sans ces multiples lunettes, les discriminations vécues ne peuvent être correctement comprises et les personnes les subissant ne peuvent dès lors être protégées de manière satisfaisante. Par conséquent, les expériences de discriminations deviennent difficiles à combattre sans les outils adéquats. Le groupe de travail sur l’intersectionnalité souligne positivement les avancées de la loi, qui permettront de visibiliser et mieux saisir la complexité des identités choisies et/ou catégories sociales imposées, de construire des analyses plus proches des réalités de vie des citoyen·ne·s, alimenter la jurisprudence autour de cette thématique et ainsi mieux protéger la population.
Au cours des échanges, les volontaires de BePax ont également échangé sur les obstacles et limites de ces changements législatifs. Le premier obstacle touche à la grande méfiance que les individus peuvent entretenir face aux lois et aux institutions. Les citoyen·ne·s peuvent se sentir exclu·e·s, voire faire face à un traitement inégal et des discriminations de la part d’institutions censées les accompagner et les protéger. Ceci est un phénomène global que nous pouvons observer dans la société. Selon le dernier Baromètre social de la Wallonie, 19% de la population wallonne entretient une méfiance envers la police, 22% sont méfiant·e·s à propos de l’éducation et 34% le sont envers la justice2. Cette méfiance peut s’expliquer par une crise plus générale de la démocratie qui s’illustre par un évitement conscient de la politique par les citoyen·ne·s, une méfiance accrue envers les personnalités politiques qui sont considérées comme ne représentant plus la population et ce phénomène est accentué par différents scandales politico-financiers ayant touché la politique belge et européenne ces dernières années3.
La méfiance envers ces institutions est encore plus importante auprès de groupes cibles de discriminations structurelles, tels que les jeunes d’origine immigrée, issu·e·s de milieux populaires4. Cette méfiance trouve également son origine dans les discriminations structurelles qui se jouent au sein de ces institutions. Nombreux sont les cas de violences de la part de la police5, les stéréotypes et biais racistes encore très présents dans l’enseignement6, une prise en charge médicale différente pour les femmes asiatiques, noires et maghrébines7, et bien d’autres exemples montrent que les individus peuvent être cibles du racisme institutionnel.
Les volontaires relèvent ainsi qu’il est nécessaire de questionner les institutions et réfléchir à des réformes globales afin de réellement accompagner les citoyen·ne·s dans leurs démarches sans que celles·ceux-ci ne doivent faire face à des discriminations qui viendraient freiner leur volonté d’obtenir justice. Nous devons faire le constat que sans ces changements profonds, les lois anti-discriminations, peu importe leur évolution, auront des difficultés à atteindre leurs objectifs.
Le deuxième obstacle mentionné par les volontaires est la méconnaissance des lois et l’usage très réduit de celles-ci en raison de leur complexité (inaccessibilité des textes juridiques, procédures longues et coûteuses, …).
En filigrane des échanges, les volontaires ont mis en lumière certains besoins auxquels la loi devrait répondre pour qu’elle puisse être efficace et que chacun·e se sente protégé·e : visibiliser les particularités et les différents croisements des identités qui peuvent exister en vue d’éviter l’exclusion. Des supports d’information qui incluent une série d’exemples pour illustrer les discriminations cumulées et intersectionnelles sont déjà créés par UNIA. Comment les rendre plus accessibles ? D’autres bénévoles ont souligné l’importance de vulgariser, sensibiliser et expliciter le contenu des procédures judiciaires et mentionner des organismes vers lesquels s’orienter pour faciliter les plaintes et leur prise en charge, de manière sécurisante.
Pour aller un pas plus loin, le groupe a également mentionné la nécessité d’avoir des conseils juridiques gratuits, des sessions d’information concernant les discriminations et les possibilités d’actions contre celles-ci. Ces actions sont déjà organisées par des organismes comme Unia et le MRAX. Il est nécessaire de leur octroyer de plus grands moyens financiers et humains afin de multiplier et démocratiser ces dispositifs.
Finalement, le groupe a précisé qu’il serait plus facile de porter plainte si les possibilités matérielles (connaître les heures d’ouverture des commissariats, savoir comment porter plainte, connaissance de la loi par les agent·es de police, acceptation de la plainte, …) étaient remplies.
Les recommandations du GT intersectionnalité
Pour conclure sa séance de travail, le GT intersectionnalité a formulé quelques recommandations très concrètes.
Le groupe s’est posé la question des critères invisibles, tels que la proximité blanche8 ou encore la santé mentale. Comment prendre ces discriminations en compte quand les individus n’ont pas la matérialité nécessaire et assez de traces en vue de porter plainte ? Cet aspect met en évidence une critique plus large sur les preuves à conserver dans la perspective de faire un signalement pour discrimination, il n’est pas toujours simple de prouver une discrimination et cela sera d’autant plus complexe concernant les discriminations cumulées et intersectionnelles qui impliquent plusieurs critères.
Par ailleurs, une autre interrogation qui découle de ces réflexions est la difficulté à prouver qu’une discrimination est intersectionnelle.
« Art. 4. […] Ces critères protégés peuvent être réels ou supposés, octroyés en propre ou par association, pris seuls ou en combinaison avec un ou plusieurs critères protégés […] »9° /1 discrimination cumulée : situation qui se produit lorsqu’une personne subit une discrimination suite à une distinction fondée sur plusieurs critères protégés qui s’additionnent, tout en restant dissociables ; 9° /2 discrimination intersectionnelle : situation qui se produit lorsqu’une personne subit une discrimination suite à une distinction fondée sur plusieurs critères protégés qui interagissent et deviennent indissociables ; ». »
L’importance du mot « indissociable » dans la distinction des deux types de discriminations sous-entend que les citoyen·ne·s devront prouver l’indissociabilité des critères, ce qui peut s’avérer être une tâche complexe et s’apparenter à une deuxième forme de violence.
Les volontaires suggèrent également de rendre plus accessibles les lieux où les plaignant·e·s peuvent se rendre pour porter plainte et obtenir des conseils juridiques sur cette matière juridique spécifique.
Des perspectives d’action
Au regard de cette nouvelle loi qui intègre l’intersectionnalité, les volontaires de BePax ont réfléchi à quelques pistes d’action concrètes pour répondre aux manquements actuels de la loi, lutter contre les discriminations et contribuer à la diffusion de l’intersectionnalité comme outil d’analyse.
- Organiser des formations pour contribuer à la sensibilisation et la vulgarisation du concept d’intersectionnalité dans tous les secteurs afin de favoriser à la fois l’échange (des discriminations subies, d’outils pour lutter contre celles-ci, d’expériences vécues), et la co-construction (de réponses, de formations, de pistes d’action) autour de ces questions. UNIA, par exemple, propose en partie ce type d’ateliers. Cette proposition du GT a inspiré BePax pour aller plus loin et organiser non seulement des ateliers citoyens sur l’analyse des lois anti-discriminations, mais également sur leur accès. Produire un podcast et d’autres ressources audiovisuelles pour vulgariser à la fois la loi et le concept d’intersectionnalité ainsi que donner des outils et des pistes concrètes aux personnes qui souhaitent faire appel à la loi. Ce projet est en cours d’élaboration par le GT intersectionnalité de BePax.
- Créer des groupes de soutien, des safe(r) spaces, afin de partager des situations difficiles et permettre aux personnes de s’empouvoirer9 individuellement et collectivement à travers l’expression de leurs vécus.
- Créer une application « Balance tes discriminations », à savoir une cartographie co-construite pour répertorier les endroits où il est plus accessible de porter plainte, indiquer les endroits particulièrement discriminatoires et les lieux plus accueillants et inclusifs, …
Ces propositions sont une première étape, mais BePax plaide pour un changement en profondeur qui questionne les institutions qui accueillent des personnes qui souhaitent signaler des discriminations. Plutôt qu’être des lieux pour palier le manquement de la chaîne judiciaire, les endroits sécures et sécurisants (comme les associations) pour celles•ceux qui vivent les discriminations, deviendraient des lieux de soutien entre pair·e·s, de prise de conscience politique et d’actions collectives face à ces enjeux.
Bianca Ledda et Solange Umuhoza.
——————————————————
Notes de bas de page
3 Tarragoni, F., Crise de la démocratie : faut-il se méfier de la méfiance citoyenne ? Politique : Revue belge d’analyse et de débat, mai 2024.
4 Pour aller plus loin sur la perception des institutions par les jeunes : Alarcon-Henriquez, A. (2022), Résiliences des Jeunesses issues de Quartiers Populaires Bruxellois : Engagements Citoyens Inclusifs, Rapport de recherche, ULB (GERME).
6 Unia, Baromètre de la diversité: Enseignement, 2018.
7 UNESSA, Du racisme dans le monde des soins, Revue Ethica Clinica n°112, décembre 2023.
8 La proximité blanche, ou le white passing, fait référence aux personnes qui tout en étant racisées sont la plupart du temps perçues comme blanches.
9 Traduction du terme « empowerment », s’empouvoirer est un processus de prise de confiance en soi et d’émancipation face aux diktats sociétaux.