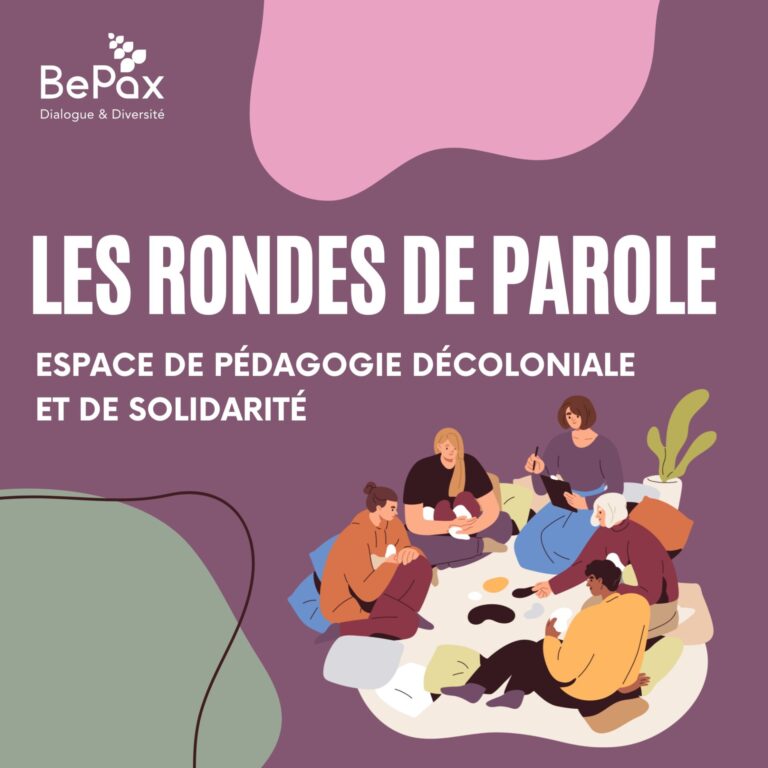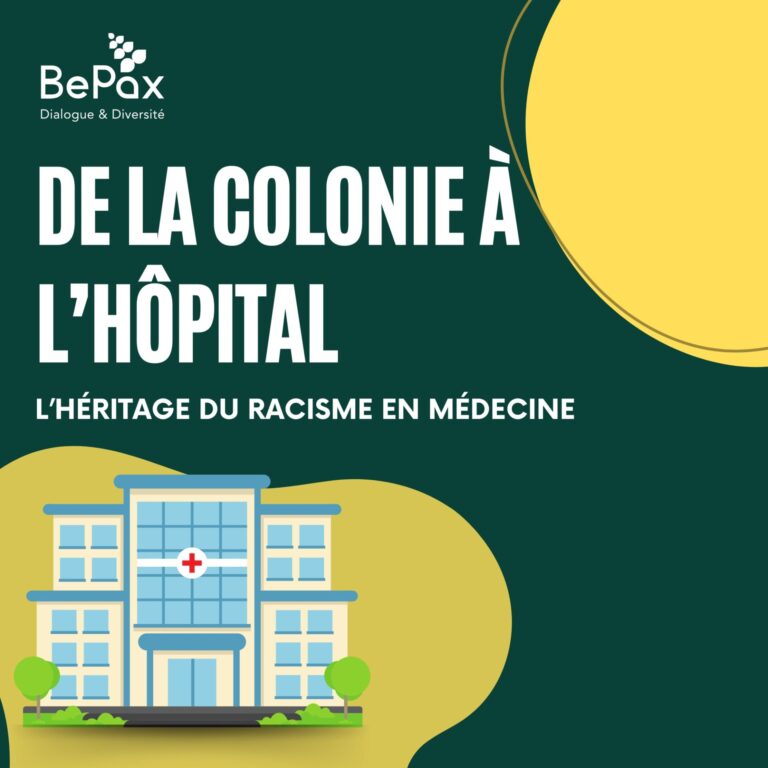Juriste de formation, Sophie Vincent travaille au Service Protection d’Unia. Le Service Protection traite les signalements des citoyens et citoyennes qui ont vécu une discrimination, délits de haine ou de propos haineux. Sophie Vincent et ses collègues accompagnent les plaignant·e·s dans leurs demandes en tentant de trouver des solutions à l’amiable ou en portant ces dossiers en justice quand cela est possible et nécessaire.

BePax a souhaité rencontrer Unia pour mieux comprendre le fonctionnement de l’institution, la façon dont les signalements sont traités et dans quelle mesure le travail a évolué depuis la reconnaissance législative des discriminations cumulées et intersectionnelles.
Comment la question de l’intersectionnalité est arrivée chez Unia ?
Sophie Vincent : En 2019, Unia a entamé des discussions sur ce qu’est l’intersectionnalité et comment se l’approprier. A cette période-là, une étudiante dans le master en études de genre, Manuela Varrasso, faisait son mémoire sur Unia et l’intersectionnalité1. À partir de sa recherche, nous avons créé un groupe de travail sur cette thématique. La première mission de ce groupe était de rédiger une note sur ce qu’est l’intersectionnalité et comment l’implémenter dans notre institution. On s’est d’abord plongé dans la théorie : que pouvons-nous lire sur l’intersectionnalité ? Quels sont les liens avec les missions d’Unia ? Comment intégrer le concept d’intersectionnalité dans notre travail ?
Sur cette base-là, nous avons défini un certain nombre de chantiers, par exemple la question de la formation interne ou celle des impacts psychosociaux spécifiques des discriminations cumulées et intersectionnelles. On peut être victime de traitements discriminatoires qui sont l’expression de rapports de forces structurels, qui vont opprimer certains groupes beaucoup plus que d’autres et qui vont avoir un impact aussi, d’un point de vue psychologique, plus important.
Au cours de la réforme des lois anti-discriminations, avez-vous rencontré des réticences à la reconnaissance des discriminations cumulées et intersectionnelles ?
S.V. : Les législations anti-discriminations prévoient, au niveau fédéral, une évaluation de la législation tous les cinq ans. Une commission est mise en place, évalue ces lois et rend un rapport sur comment les améliorer. Dans son dernier rapport d’évaluation, la commission mentionnait la nécessité d’implémenter la discrimination multiple et intersectionnelle. Pendant 1 an, Unia a échangé avec le cabinet [de la Secrétaire d’État à l’Egalité des genres, à l’Egalité des chances et à la Diversité] sur les modifications à faire et comment les faire. Pour changer la loi, le secrétariat pour l’égalité des chances devait s’accorder avec le ministre de la Justice. La proposition devait ensuite être soumise au Kern2, donc à tous les partis du gouvernement. Dès lors, cela a fait l’objet de tractations, il a pu y avoir des oppositions sur certains points spécifiques mais pas de réticences majeures à la reconnaissance de ces concepts. Progressivement, nous sommes arrivés à la loi du 28 juin 2023, qui affirme la discrimination intersectionnelle et la discrimination cumulée.
Aujourd’hui, avoir une reconnaissance légale des discriminations cumulées et intersectionnelles est une immense victoire. Avant cela, il y avait des dossiers qui ne passaient pas, comme un refus de stage pour une femme qui porte le foulard. Elle avait plaidé la discrimination intersectionnelle, mais le juge affirmait que ce type de discrimination n’existait pas à défaut de textes législatifs. Il n’a donc pas suivi le raisonnement de la plaignante. Avec cette nouvelle base légale, ce sera plus facile de défendre des cas de discrimination intersectionnelle et cumulée. En Europe, il y a très peu de pays qui ont une législation similaire. Nous sommes vraiment content·e·s !
BePax : Concrètement, comment l’intersectionnalité est-elle incluse dans les dossiers ? C’est Unia qui tente de montrer l’aspect intersectionnel ou c’est à la charge des plaignant·e·s ?
S.V. : En fait, les gens ne viennent pas en parlant de discriminations intersectionnelles. Les personnes nous expliquent leurs situations et nous voyons si le cadre juridique peut les aider. Le cas suivant s’est présenté à nous. Une dame qui est en situation d’handicap a postulé à une offre d’emploi et elle a dû faire des tests spécifiques auxquels n’ont pas été soumises les autres personnes3. Par la suite, elle n’a pas été engagée. À partir de ces premiers éléments, il y a une présomption de discrimination. Nous pensons que le refus d’embauche et le fait qu’elle ait été soumise à des tests spécifiques sont liés à son handicap. Quand on a interpellé l’employeur, il a répondu « non, c’est parce qu’elle est enceinte ». Ici, nous sommes sur un cas où la personne qui dépose plainte a été discriminée car c’est une femme et parce qu’elle est en situation d’handicap. Nous sommes donc en mesure de dire qu’il y a une double discrimination. En prenant les critères séparément, si cette dame avait seulement un handicap, elle n’aurait pas été engagée ; et uniquement enceinte, elle n’aurait pas été engagée non plus. Donc, si les deux critères étaient pris séparément, il y aurait tout de même deux traitements discriminatoires. Une discrimination cumulée est plus facile à prouver, parce qu’il suffit de prendre les critères séparément et constater s’il y a aussi une discrimination.
La discrimination intersectionnelle, quant à elle, vise la situation dans laquelle des personnes se trouvent à l’intersection de plusieurs critères sans qu’il ne soit vraiment possible de les distinguer pour prouver un traitement discriminatoire sur la base d’un seul de ces critères. C’est un peu plus complexe. Une femme qui porte le foulard est le meilleur exemple. Dans l’affaire de la STIB4, une femme qui porte un foulard islamique n’est pas engagée en raison d’une interdiction du port de signes convictionnels. Est invoquée une discrimination intersectionnelle sur la base des critères de la conviction religieuse et du genre. Si l’on analyse distinctement chacun de ces critères, il est possible de conclure à l’absence de discrimination. En effet, une telle interdiction ne cause pas préjudice à toutes les femmes, seulement à celles qui expriment une conviction religieuse par le port du foulard. En outre, toutes les personnes musulmanes ne sont pas impactées par l’interdiction du port de signes convictionnels, seulement certaines femmes. C’était d’ailleurs l’argument des avocats de la STIB, auquel le juge n’a pas fait droit. Ce que montre l’intersectionnalité est que le croisement de deux critères crée une discrimination spécifique et non une addition de discriminations. C’est technique, mais ça correspond à une réalité.
Pour donner un autre exemple, l’Institut [pour l’égalité des femmes et des hommes] s’est pourvu en justice en 2022 avec un dossier qui s’apparente à une discrimination intersectionnelle. Le vaccin pour le papillomavirus n’était pas remboursé pour les hommes, mais l’était pour les femmes. Il y avait donc une discrimination sur la base du genre. L’Institut est même allé plus loin en disant que c’est une discrimination intersectionnelle sur la base du genre et de l’orientation sexuelle. Le vaccin est administré aux femmes et ne l’est pas aux hommes. Les hommes ne sont donc pas protégés contre la maladie. Cependant, s’ils ont des rapports sexuels avec des femmes, ils sont immunisés par association. Dès lors, les seuls qui ne sont pas immunisés sont les hommes qui ont des pratiques sexuelles avec d’autres hommes. La justice a reconnu une discrimination intersectionnelle sur la base du genre et de l’orientation sexuelle. Les hommes ayant des pratiques sexuelles avec d’autres hommes sont préjudiciés, car ils peuvent contracter le virus sans avoir l’occasion de s’immuniser par une pratique hétérosexuelle. C’est la première décision de justice reconnaissant la discrimination intersectionnelle de manière explicite.
Quelles sont les complications que vous rencontrez à implémenter la notion d’intersectionnalité dans les dossiers ?
S.V. : En pratique, il y a la question de la comparabilité et la question de la justification.
Pour prouver une discrimination, il faut montrer qu’une personne a été traitée moins favorablement qu’une autre qui se trouve dans une situation similaire sur la base d’un critère protégé. Pour démontrer une discrimination, il faut toujours une comparabilité. Mais que faire quand on est sur l’intersectionnalité où il ne s’agit pas simplement de comparer sur un seul critère (disons un homme « blanc » et un homme « noir »), mais que la comparaison sera, par exemple, un homme « blanc » et une femme « noire ».
Ensuite, vient la question des justifications. En fonction des domaines, du champ d’application de la loi et des critères protégés, la justification ne sera pas la même. Dans certains cas, on ne peut pas justifier une discrimination. Dans d’autres cas, on peut justifier en démontrant que c’est légitime et proportionnel, comme dans le cas d’une exigence professionnelle.
Qu’est-ce qu’une justification quand on parle de discrimination ?
La justification est l’idée que toute différence de traitement n’est pas toujours une discrimination. Dans certaines circonstances et à certaines conditions, une personne qui est accusée de discrimination peut démontrer que cette différence de traitement poursuit un but légitime et est proportionnel. Par exemple, un employeur qui licencie un·e travailleur·euse en raison de sa santé peut justifier cela en disant que la taille de son entreprise ne permet pas de gérer des absences de longue durée, car cela impacte de manière significative sa production. Il y a dès lors une différence de traitement, mais ce n’est pas une discrimination parce que la différence de traitement est justifiée.
Concrètement, il faut remplir trois conditions pour justifier une distinction de traitement :
- La différence de traitement poursuit-elle un objectif légitime ?
- Les moyens employés sont-ils appropriés ?
- Les mesures prises sont-elles raisonnables par rapport à l’objectif ?
Par ailleurs, la justification concerne uniquement certains critères protégés : l’état de santé, les caractéristiques physiques ou génétiques, la langue, les convictions politiques, l’origine et la condition sociale, la fortune, la naissance, l’état civil et la nationalité.
Les autres critères protégés ne sont jamais justifiables ou seulement dans des situations très spécifiques : le handicap, le genre, l’âge, les critères dits raciaux (couleur de peau, origine nationale ou ethnique, nationalité, ascendance), l’orientation sexuelle, les convictions philosophiques ou religieuses. Par exemple, une différence de traitement serait autorisée pour une personne malvoyante qui désire être chirurgienne.
Quand il s’agit d’une discrimination multiple, cela peut poser question. Que se passe-t-il quand il y a plusieurs critères qui peuvent entrer en jeu, comme la santé et l’origine nationale ou ethnique, la justice va-t-elle permettre de justifier cette différence de traitement ? Le législateur a décidé que devait s’appliquer le régime de justification qui est le plus favorable à la victime. Ainsi, s’il est prévu par la loi qu’une différence de traitement basée un critère ne peut jamais être justifiée, une distinction de traitement intersectionnelle impliquant ce critère ne pourra jamais l’être non plus.
BePax : Comment réagissez-vous quand il n’y a pas du tout de solution ? Que faites-vous quand vous recevez une plainte et qu’il n’y a pas de preuve ?
S.V. : Unia ne peut pas faire grand-chose quand il n’y a pas de preuve en l’absence de pouvoir d’investigation. Dans un premier temps, nous allons nous demander comment la victime peut récolter des preuves. Des personnes peuvent-elles témoigner ? Y a-t-il des preuves audios ? Nous essayons d’encourager les gens à garder le plus de traces possibles, comme enregistrer les conversations, rapporter les faits à leur hiérarchie par écrit et garder les traces de mails, garder les sms, etc. Même en cas de doute sur la recevabilité en justice de ces preuves, c’est important de le faire. Il y a d’ailleurs de la jurisprudence qui montre que ces preuves peuvent être admissibles dans certains dossiers. J’ai eu le dossier d’une cheffe qui a eu des propos racistes envers une dame et cette dernière a eu le réflexe de lui écrire à ce sujet. Dès lors que sa cheffe n’a pas contesté avoir tenu les propos, c’est un début de preuve. S’il n’y a pas d’échange, ni de preuve, c’est très difficile d’accompagner les plaignant·e·s.
Une des critiques formulées par le GT intersectionnalité est la technicité de certains propos dans les lois anti-discrimination et l’explication des discriminations cumulées et intersectionnelles. Quels sont les moyens qui vont être mis en œuvre pour faciliter la compréhension de la loi ?
S.V. : Le Service Prévention d’Unia a préparé une vidéo qui présente quatre mesures de la nouvelle loi, dont les discriminations cumulées et intersectionnelles. Le but est que ce soit le plus accessible possible, notamment avec des exemples pratiques. Nous prenons également le temps de présenter cette loi à différents organismes comme les conseiller·ère·s diversité dans les syndicats, qui sont les relais de la lutte contre les discriminations. J’ai aussi fait cette présentation auprès du service de lutte contre les discriminations d’Actiris. Par ailleurs, tou·te·s les collègues sont formé·e·s et peuvent reconnaitre les discriminations intersectionnelles et cumulées quand des victimes de discrimination font un signalement auprès de nos services.
On a parlé de la sensibilisation des citoyens et citoyennes. Faites-vous cela aussi auprès des juges ?
S.V. : Pour devenir juge, il y a plusieurs voies. Première possibilité, en ayant dix ans de pratique au Barreau et en passant un examen d’accès direct à la profession. Il est aussi possible de devenir juge après deux ans de pratique en passant l’examen de la magistrature pour obtenir le statut de stagiaire judiciaire pendant deux ans. Durant ce stage judiciaire, les juristes doivent suivre des formations, dont celles dispensées par Unia. Chaque année, nous avons ce qui correspond à deux journées de formation avec les stagiaires judiciaires. Des personnes du Service Prévention essaient de sensibiliser sur les stéréotypes, la manière dont ils vont influencer l’appréciation d’une situation et être à l’origine d’une discrimination, et aussi informer sur les nouvelles formes de discrimination, cumulées et intersectionnelles. Nous n’avons pas accès aux personnes qui deviennent juge en passant par d’autres chemins.
On n’a pas encore abordé la question de l’évaluation de la loi. Pour Unia, la loi va-t-elle assez loin dans les revendications ? Est-ce qu’il y a une volonté de faire évoluer la loi ?
S.V. : La reconnaissance est déjà une grande victoire ! Mais il y a des choses à clarifier au niveau des sanctions. On aurait voulu garantir, par exemple, que l’indemnisation soit nécessairement multipliée en fonction du nombre de critères en jeu quand il y a une discrimination cumulée. On voulait laisser le pouvoir d’appréciation seulement dans l’hypothèse de discriminations intersectionnelles. Quand il y a une discrimination cumulée, il s’agit de deux critères donc deux traitements discriminatoires qui s’additionnent. Les indemnités devraient donc aussi pouvoir s’additionner. Lors d’une discrimination intersectionnelle, le comportement discriminatoire est unique, il est le résultat de l’intersection des critères. Le cumul automatique n’a donc pas beaucoup de sens. Actuellement, c’est l’appréciation du juge qui prime dans les deux cas s’il y a cumul de l’indemnisation ou pas.
Enfin, je pense que la loi doit d’abord passer par une phase d’expérimentation qui sera évaluée ensuite. Il faut maintenant observer comment les citoyens et citoyennes, mais aussi les acteurs de la lutte contre les discriminations, s’approprieront et utiliseront ce nouveau cadre légal.
Propos recueillis par Bianca Ledda, Solange Umuhoza, et Emmanuella Auguste Therasse.
————————————————–
Notes de bas de page
1 Varrasso, Manuela.Effets et enjeux de la mise en pratique de l’intersectionnalité dans un equality body. Le cas d’Unia. Faculté de philosophie, arts et lettres, Université catholique de Louvain, 2019. Prom. : Paternotte, David.
2 Le Kern est le conseil des ministres restreint, qui réunit le Premier ministre et les vice-Premiers du gouvernement fédéral.
4 En mai 2021, la STIB a été condamnée pour discrimination fondée sur les convictions religieuses et le genre.