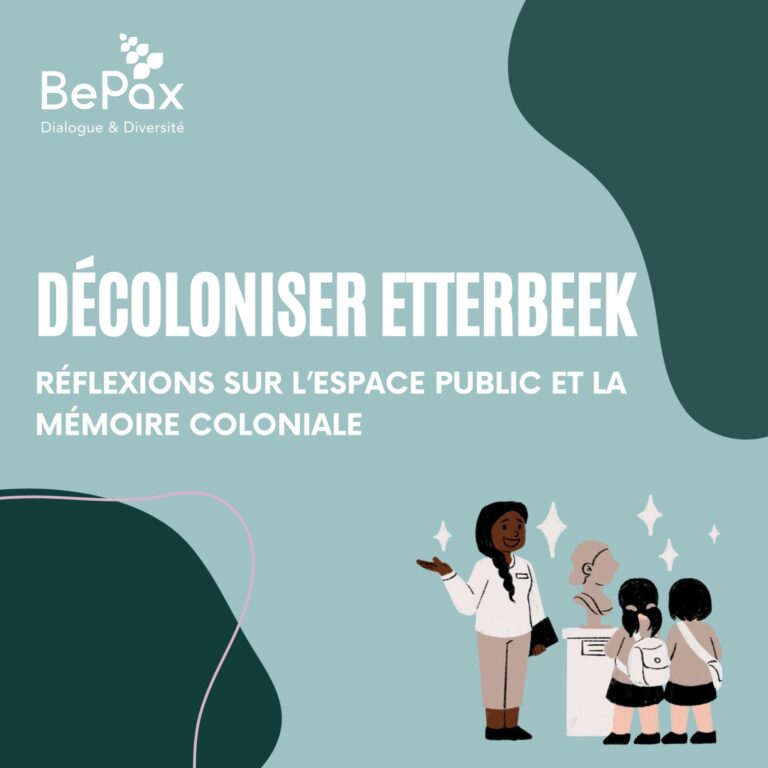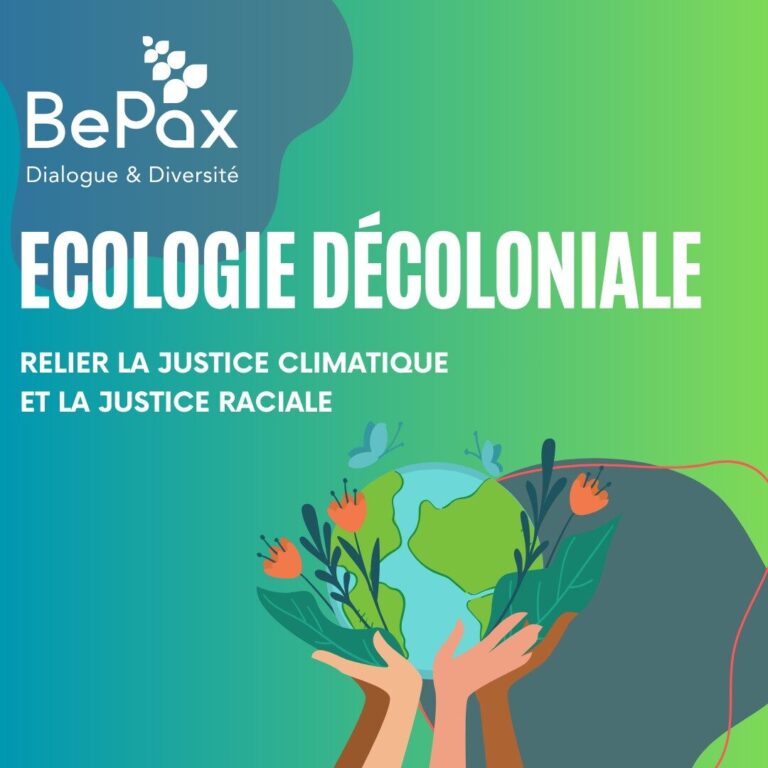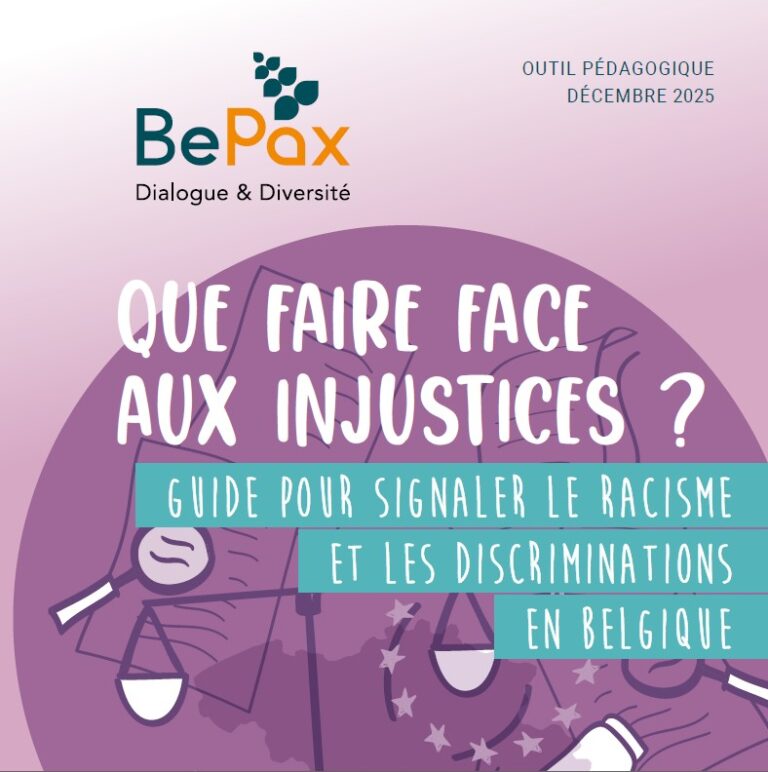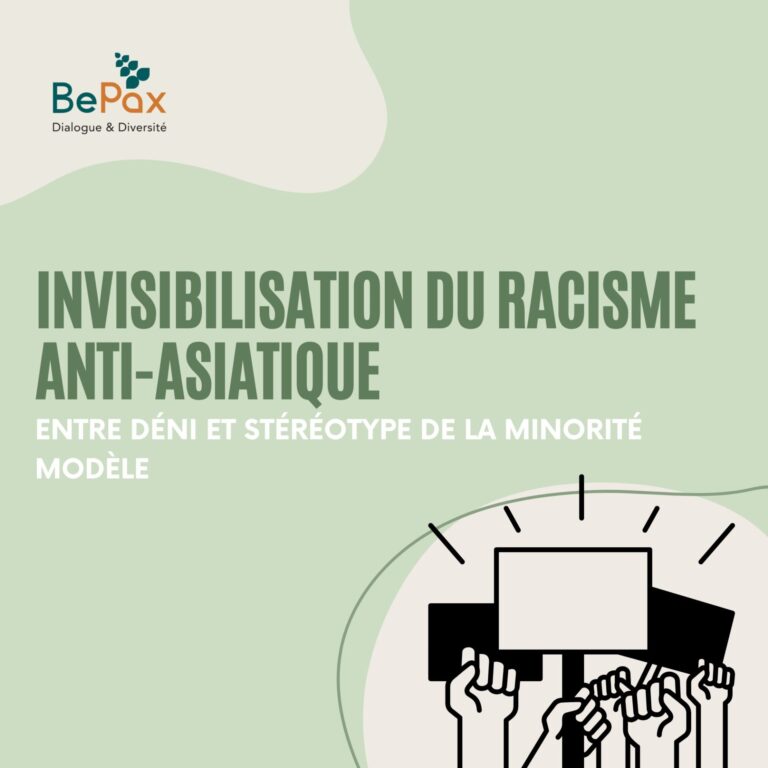Cette analyse émane des réflexions de l’atelier du Café Politique sur la thématique « Enjeux antiracistes des élections communales : décolonisation de l’espace public (du fédéral au communal – focus sur Etterbeek) ». La volonté de prendre à bras le corps ce sujet s’appuie sur l’impression des participant·e·s qu’une majorité de leurs concitoyen·ne·s ne faisait pas attention aux traces coloniales dans l’espace public alors que, selon elles·eux, cela devrait relever de l’intérêt général. Le groupe a donc décidé de s’emparer de la question afin de mieux la comprendre et tenter de formuler des pistes d’action pour une sensibilisation plus large sur le débat.

Portrait général du débat sur la décolonisation de l’espace public en Belgique
En 2020, le meurtre de George Floyd a ravivé le mouvement Black Lives Matter, né en 2013 à la suite du meurtre de Trayvon Martin par un agent de police, et a conduit à une vague de rassemblements antiracistes à travers le monde, se mobilisant en particulier sur des problématiques comme les violences policières racistes. Ces actions ont également permis de visibiliser la problématique de la décolonisation de l’espace public, enjeu déjà présent dans l’espace médiatique et politique belge. En effet, en Belgique, des militant·e·s afrodescendant·e·s et décoloniaux luttaient déjà pour repenser l’espace public en adoptant une lecture antiraciste. Ce mouvement décolonial a connu quelques victoires : En 2018, la commune d’Ixelles a inauguré le Square Patrice Lumumba dans le quartier de Matonge[1] à Bruxelles, en hommage au premier Premier ministre de la République démocratique du Congo, 58 ans après l’indépendance du pays. En 2022, la statue d’Emile Storms, lieutenant-général belge chargé de la mission coloniale congolaise sous Léopold II, est retirée du Square de Meeûs à Ixelles.
Ces avancées sont le fruit d’une longue bataille à différents niveaux de pouvoirs.
Au niveau fédéral :
En 2020, sous pression de la société civile et de propositions de résolution sur ce thème par différents groupes politiques, une commission spéciale sur le passé colonial de la Belgique est mise sur pied par le Parlement fédéral. Cette commission mandate alors dix expert·e·s, qui vont rendre un rapport d’expertise après une année de travail. Des recommandations importantes sont mises en avant, notamment la présentation d’excuses officielles et la restitution d’objets spoliés présents dans les musées belges. La commission va s’appuyer sur ces recherches pour mener ses propres travaux et rédiger ses conclusions dans un rapport de plus de 700 pages en 2023. Le travail de la commission fut très important tant au niveau symbolique qu’historique, mais elle va faire face à un blocage politique qui va se conclure par une non-validation du rapport. Il n’y a donc pas de reconnaissance officielle des recommandations qui en émanent.
| Le cas spécifique de la décolonisation des musées Le Café politique s’est également penché sur d’autres grands symboles de la colonisation comme l’AfricaMuseum, qui tente bien que mal de se questionner sur son rapport à la colonisation. Il n’y a, pour le moment, aucune obligation législative pour les musées d’amorcer un processus de décolonisation, mais il y a bien une pression de la société civile. Plutôt qu’un musée sur l’Afrique, ces organisations militent pour une transformation du musée en un lieu sur la (dé)colonisation. Elles revendiquent également plus d’inclusion et de diversité dans tous les départements afin que le processus de décolonisation de l’institution soit réalisé avec l’appui d’expert·e·s et de personnes concernées par les conséquences de cette colonisation. Les participant·e·s ont aussi relevé que la démarche de décolonisation de l’espace public soulève certaines questions, notamment celle de la restitution des objets obtenus dans des conditions de violences et d’exploitation des territoires et des peuples locaux. Le groupe s’est alors demandé si c’était aux musées et aux anciens pays colonisateurs de décider et de dicter ce qu’il faudrait faire de ce patrimoine. Penser cela relève, en fait, d’une vision paternaliste et colonisatrice toujours présente dans les représentations des pays occidentaux. Les expert·e·s de la problématique de la restitution des œuvres d’arts expliquent que cela doit faire l’objet d’un dialogue dans les deux sens et non l’imposition d’une certaine vision, mais il est essentiel que la propriété de ces objets reviennent aux pays d’origine afin qu’ils puissent bénéficier de leur reconnaissance patrimoniale, symbolique et pécuniaire[2]. En 2022, le parlement fédéral a adopté une loi sur le principe d’aliénabilité des biens liés au passé colonial de l’Etat belge afin de permettre leur restitution. A présent, c’est aux différentes institutions ayant des œuvres et divers objets issus de la période coloniale de mener un travail d’inventaire des biens concernés et de lancer des procédures pour les restituer. |
Au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles :
Concernant l’enseignement, un enjeu majeur dans la lutte contre les stéréotypes et les discriminations, le gouvernement précédent de la Fédération Wallonie (2019-2024) s’était engagé à revoir de manière globale les référentiels concernant l’apprentissage de l’histoire de la colonisation belge.
Le référentiel des sciences humaines (1e primaire – 3e secondaire) est en cours de révision afin de mieux inclure l’histoire coloniale[3]. Toutefois, c’est un travail de longue haleine mené par des expert·e·s et qui doit être validé par le parlement. Or, le gouvernement actuel n’a pas repris ce point dans sa déclaration de politique communautaire. Nous pouvons donc nous questionner sur la priorité de la thématique dans les politiques actuelles.
Au niveau de la Région Bruxelles-Capitale :
Le 17 juillet 2020, le parlement bruxellois a adopté la proposition de résolution « relative à la décolonisation structurelle et inclusive de l’espace public bruxellois », en reconnaissant la décolonisation de l’espace public comme l’objectif d’une politique publique. Des initiatives ont alors été lancées pour examiner et réévaluer la présence de symboles coloniaux dans la région. Un groupe de travail a été mis sur pied et a publié un rapport en février 2022 après 15 mois de recherches et de discussions.
Ce rapport propose un cadre de réflexion et une série de recommandations pour le gouvernement bruxellois. Parmi les mesures concrètes, un plan de 14 actions a été présenté en mai 2023 pour avancer dans ce processus. Cependant, nous n’avons pas encore observé d’aboutissements concrets de ces réflexions, la problématique se retrouve à nouveau dans une phase de stagnation politique. Néanmoins, un projet au sein du service public bruxellois en charge de l’urbanisme, du patrimoine culturel et de la revitalisation urbaine a été lancé pour travailler sur la mise en œuvre concrète des recommandations.
Focus sur la commune d’Etterbeek[4] :
26 rues sur les 185 que compte la commune témoignent d’une empreinte coloniale, cela représente 14% de rues du territoire qui portent un nom lié à l’époque coloniale et militaire. La commune a connu une forte croissance démographique durant l’entre-deux-guerres, il a alors fallu créer des nouveaux quartiers et donc attribuer des noms aux nouvelles artères. Outre les noms de rue, nous pouvons aussi observer à Etterbeek différents monuments, statues et sculptures témoignant et datant de l’époque coloniale, comme le Square Léopoldville, l’Avenue Commandant Lothaire, le Boulevard Général Jacques, la rue et station de métro Pétillon ou le “Monument aux pionniers belges au Congo” de Thomas Vinçotte.
En juin 2020, en continuité de l’élan créé par les mobilisations antiracistes, le Collège communal de la commune d’Etterbeek a déposé une motion pour la mise en place d’une Commission participative mixte en vue d’une meilleure compréhension de l’histoire de la colonisation belge à travers ses représentations dans l’espace public à Etterbeek. L’objectif des travaux de cette commission était de permettre à la population, dans un cadre participatif et démocratique, de s’exprimer sur ce qu’elle souhaite : le maintien des traces de l’histoire de la colonisation, leur contextualisation ou leur modification, à améliorer la prise en compte et la connaissance de ces traces coloniales présentes sur le territoire communal.
Cette commission était composée de 10 membres du Conseil communal et de 20 citoyen·ne·s tiré·e·s au sort. Le tirage au sort devait respecter autant que possible trois principes : une parité homme-femme ; 1/3 de personnes ayant moins de 35 ans ; une représentativité des différents quartiers de la commune. Les membres ont aussi reçu l’appui de deux historien·ne·s, Chantal Kesteloot et Romain Landmeters, et d’un prestataire externe spécialisé en participation citoyenne.
Après plus de 16 mois d’auditions, de travaux, d’ateliers et d’échanges, le rapport de cette commission, publié en septembre 2023, dégage 5 recommandations :
- Mettre en place une journée Etterbeekoise de la décolonisation en l’intégrant dans la quinzaine de la solidarité internationale.
- Contextualiser les actions posées par les personnages dont les rues et les monuments portent le nom.
- Contextualiser les traces de l’époque coloniale dans l’espace public etterbeekois.
- Ajouter au nom de rues un deuxième nom, officieux, qui reflète les connaissances actuelles sur la colonisation.
- Changement de noms de rue.
Les votes des membres de la commission indiquent un soutien important uniquement pour deux recommandations, à savoir celles sur la mise en place d’un événement thématique et la contextualisation des rues et monuments.
Quelques pistes pour continuer le dialogue sur la décolonisation de l’espace public
La colonisation a été une période d’exploitation et de violence. Continuer à représenter cette période – par le biais de monuments, de noms de rues, d’objets culturels, etc. – constitue une continuation de cette violence pour certain·e·s citoyen·ne·s, notamment pour les diasporas africaines et constitue une vitrine peu flatteuse de la Belgique vue de l’extérieur. Il est alors essentiel de continuer à militer pour une décolonisation de l’espace public afin que chacun·e puisse se sentir inclus·e au sein de celui-ci et pour la Belgique de marquer une distance claire avec les idéologies coloniales du passé. L’objectif de la seconde partie du Café Politique était d’explorer différentes manières possibles de décoloniser l’espace public, d’en débattre et de dégager des pistes d’action.
La première idée du groupe vise la question de l’inclusivité, et ceci constitue une condition nécessaire pour toutes les autres actions à mener. Il est fondamental que les personnes directement impactées par le racisme soient pleinement partie prenante des différents dispositifs mis en place pour repenser l’espace public. Par ailleurs, il est également important que les commissions participatives ne servent pas de verni démocratique. Leurs recommandations doivent être sérieusement considérées lors des prises de décision politiques.
Une seconde piste d’action concerne la sensibilisation à travers des actions concrètes comme ce que le Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations a pu effectuer en envoyant un courrier aux habitant·e·s de l’Avenue Commandant Lothaire pour expliquer qui était le personnage et qu’il était possible d’interpeller la commune pour changer le nom de leur rue.
Pour poursuivre, les participant·e·s ont échangé sur le système éducatif. Premièrement, il faudrait que l’histoire de la colonisation et son enseignement soit une priorité du gouvernement afin de continuer le travail de révision des manuels scolaires pour les enrichir d’une représentation plus juste de la colonisation belge au Congo. Cette mise à jour devrait également s’efforcer de dépasser une perspective eurocentrée dans la narration des faits historiques. Par ailleurs, il serait pertinent d’instaurer un système d’évaluation régulier de ces manuels, afin qu’ils puissent s’ajuster à l’évolution des connaissances sur cette thématique. Ensuite, pour des changements à mettre en place plus spontanément, il serait intéressant d’instaurer des journées éducatives dédiées aux discriminations et au racisme au sein des établissements scolaires, comme il existe d’autres journées sur diverses thématiques. Cela permettrait de sortir de l’école, en apprenant à travers une pédagogie plus active et stimulerait une prise de conscience pratique et factuelle. Par exemple, le projet Inclusion et Représentation dans l’Espace Public (IREP) a proposé des visites guidées décoloniales d’Etterbeek.
Pour finir, les membres du Café politique pensent que l’organisation d’un projet fédérateur comme un événement culturel est une piste d’action concrète et réalisable à leur échelle. Pour autant, le groupe a conscience que les changements principaux doivent émaner des institutions sociales et politiques afin de faire évoluer les représentations et aller vers une décolonisation de l’espace public et des esprits.
Rédigée par Gauthier De Locht et Vincent Yang sur base des échanges du Café politique du 24 septembre 2024.
Editée par Solange Umuhoza.
————————————–
Bibliographie :
Commission spéciale chargée d’examiner l’Etat indépendant du Congo (1885-1908) et le passé colonial de la Belgique au Congo (1908-1960), au Rwanda et au Burundi (1919-1962), ses conséquences et les suites qu’il convient d’y réserver. Rapport des experts, 26/10/2021
Rapport : « Vers la Décolonisation de l’espace public en Région de Bruxelles-Capitale : cadre de réflexion et recommandations », 17/02/2022 :urban.brussels
Rapport sur les travaux de la Commission Participative Mixte de la Commune d’Etterbeek, septembre 2023 : https://etterbeek.brussels/sites/default/files/publications/pdf/2023-10/20230908_Rapport%20Final%20CPM_Pass%C3%A9%20colonial.pdf
Passé colonial: la commune privilégie la contextualisation | Etterbeek
IREP: visites guidées décoloniales d’Etterbeek | Etterbeek
Passé colonial à Etterbeek : contextualiser sans déboulonner – RTBF Actus
Etterbeek va contextualiser les statues, rues et monuments coloniaux dans l’espace public – La Libre
Etterbeek : des citoyens se penchent sur le passé colonial belge – Le Soir
Etterbeek rebaptise et féminise ses rues au nom trop ‘colonial’ – RTBF Actus
Communiqué de presse du GT sur la décolonisation de l’espace public en Région de Bruxelles-Capitale, « Un pas important vers la décolonisation de l’espace public dans la Région de Bruxelles-Capitale a été franchi », 17/02/2022
Microsoft Word – Etude 3 + Recontextualisation Monuments Coloniaux (1).doc (bamko.org)
Microsoft Word – 5. Le Square Patrice Lumumba +.docx (bamko.org)
Microsoft Word – 1. Le buste de Léopold II a été déboulonné.docx (bamko.org)
Recherche en co-création IREP (Inclusion et représentation dans l’espace public) – co-create financé par Innoviris :
IREP (Inclusion et Représentation dans l’Espace Public) – Co-create : Co-create (cocreate.brussels)
BX1 (2022) : Décolonisation de l’espace public : la statue du général Storms a été démontée (youtube.com)
Bx1 (2022) : Versus : la décolonisation de l’espace public au cœur des débats bruxellois (youtube.com)
Bx1 (2024) : Comment décoloniser l’espace public sans pour autant effacer l’histoire de la colonisation ? (youtube.com)
La première – déclic (2022) : (20+) Vidéo | Facebook
Kiffe ta race : #85 – Paris (dé)colonial (youtube.com)
[1] Tirant son nom d’un quartier de Kinshasa, Matonge est un quartier regroupant de nombreux commerces et associations issus des diasporas africaines, principalement congolaises.
[2] Pour aller plus loin sur cette thématique, consultez les principes éthiques pour la gestion et la restitution des collections coloniales en Belgique rédigés par Restitution Belgium.
[3] Les nouveaux référentiels sont attendus pour 2027 et devraient être présentés aux élèves de 2e secondaire cette année-là. Quant au contenu, nous n’avons aucune information à ce stade.
[4] Le Café politique a décidé de travail sur Etterbeek car les bureaux de BePax se situent dans cette commune.