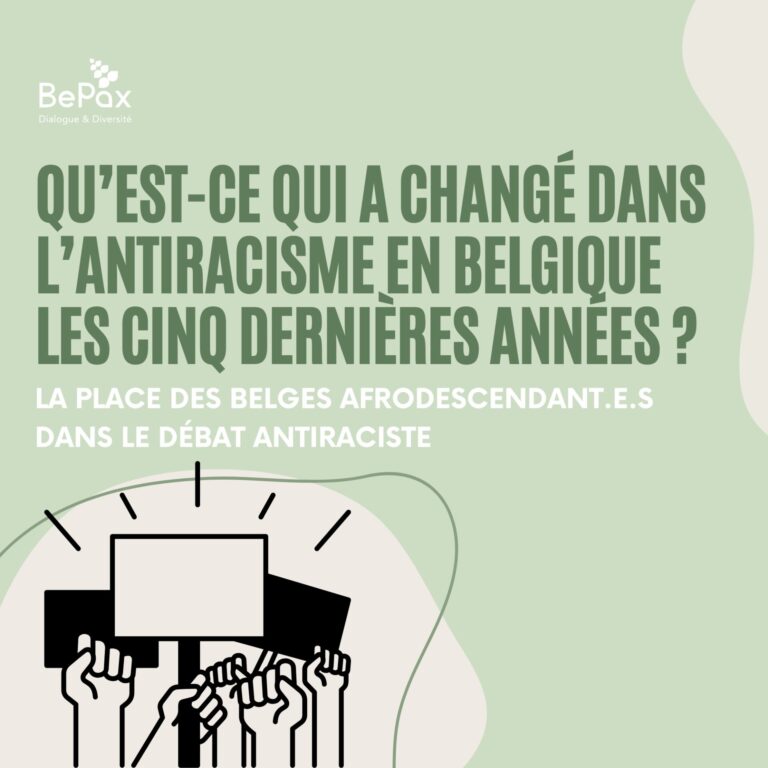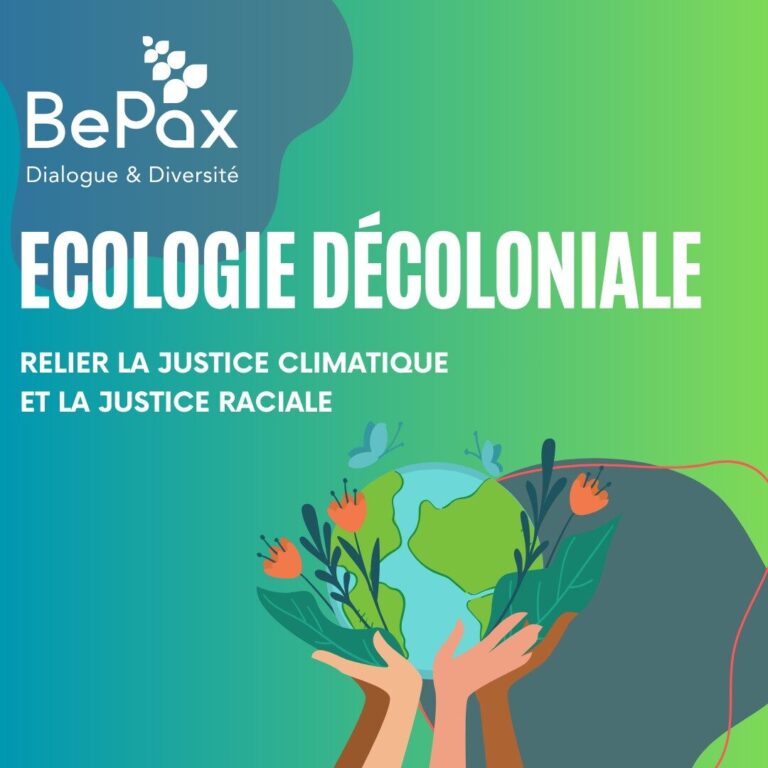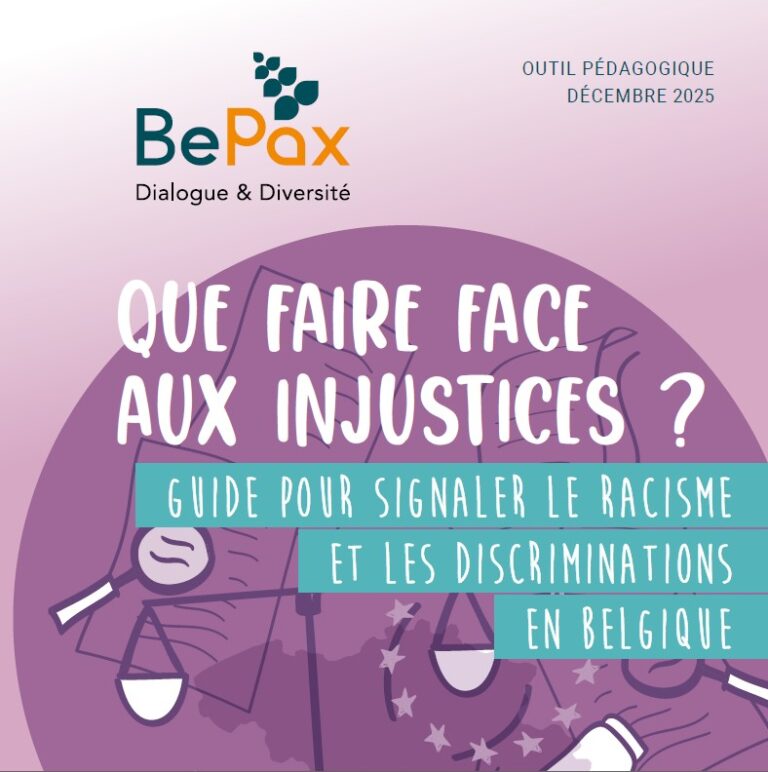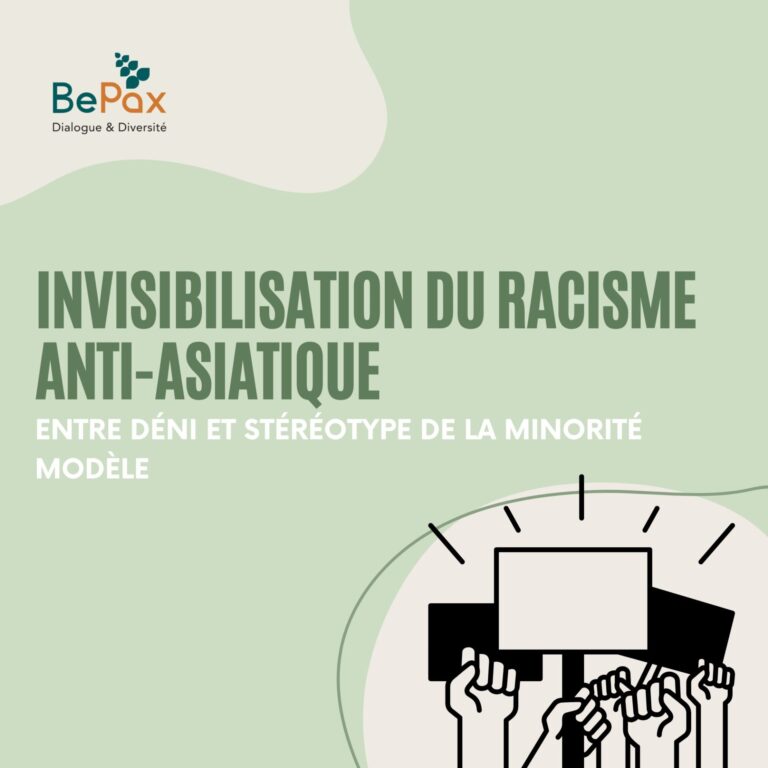Introduction
Le combat contre le racisme a une longue histoire, aussi longue que l’histoire du racisme lui-même. Les personnes et les groupes sociaux historiquement ciblés par ce système de domination – les Juif·ve· s, les Noir·e·s, les Roms, les Arabes et d’autres – ont toujours et de longue date porté la lutte antiraciste mais celle-ci a aussi reçu et continue de bénéficier, à des degrés divers, de manière passive ou active, du soutien et de la solidarité de leurs allié·e·s. Comme toutes les luttes, l’antiracisme a évolué au gré des rapports de force et des dynamiques idéologiques et politiques traversant les sociétés.
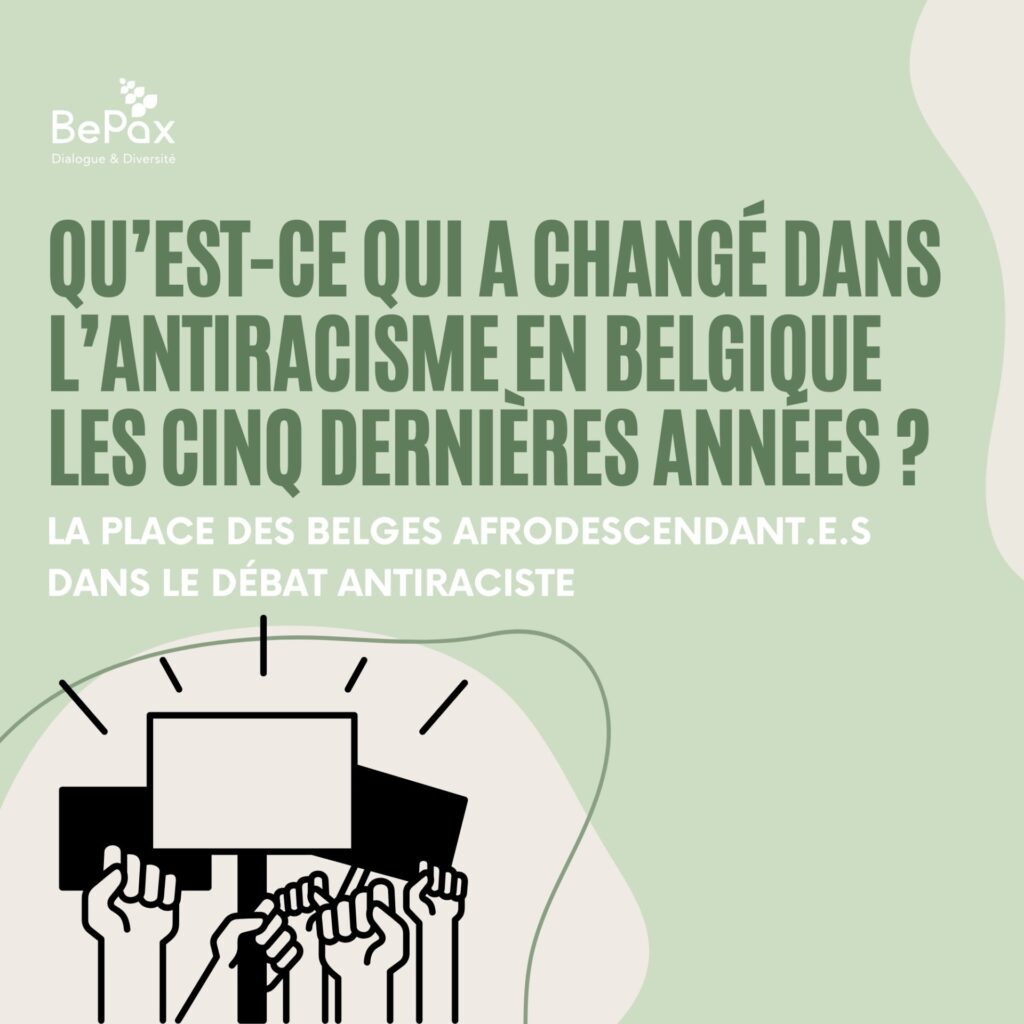
Pour comprendre les transformations de l’antiracisme belge des cinq dernières années, dans le sillage de la manifestation Black Lives Matter du 7 juin 2020, la plus grande manifestation antiraciste de l’histoire de la Belgique1, nous aborderons quatre dimensions qui nous semblent les plus significatives :
- La remise en question de la domination de l’antiracisme moral et le renforcement de l’antiracisme politique ;
- Les diverses manières d’intégrer ces évolutions par la société civile installée – spécifiquement les mouvements antiracistes ;
- Les réponses de l’espace politique et des institutions publiques à cette demande sociale et à ces mobilisations ;
- Et enfin, l’enjeu du rôle des personnes et des groupes subissant le racisme dans le combat antiraciste.
Ces dimensions seront analysées à la lumière de l’histoire longue des mouvements antiracistes en Belgique et des rapports de force qui le sous-tendent. Nous essaierons dès lors de saisir la portée de ces transformations, et ce qu’elles disent des tendances de fond qui travaillent notre société ainsi que les défis stratégiques actuels du mouvement antiraciste et des organisations luttant pour l’égalité et l’émancipation en général.
L’antiracisme traditionnel à l’épreuve de Black Lives Matter
Avant d’aller plus loin, définissons d’abord les deux principales approches de l’antiracisme dont nous allons longuement discuter tout au long de cet article. L’antiracisme moral se concentre sur l’individu, critiquant l’immoralité de son racisme. Cette vision de l’antiracisme voit essentiellement le racisme comme le fait d’individus remplis de préjugés, à une ouverture d’esprit limitée et à l’intentionnalité questionnable. Quand les situations de discriminations sont prises en compte, on les considère comme conjoncturelles et interpersonnelles. Pour lutter contre le racisme, il suffirait donc d’éduquer tout un chacun à déconstruire ses préjugés et promouvoir la tolérance. En revanche, l’antiracisme politique déplace le regard de l’individu vers la société et voit le racisme comme un système de hiérarchie sociale et de domination, octroyant des privilèges à un groupe dominant et discriminant les groupes ciblés par le racisme. Dans sa dimension décoloniale, l’antiracisme politique rappelle que le racisme est enraciné dans l’histoire coloniale de l’Europe. Aujourd’hui, cela se traduit dans la pratique par, entre autres, de la ségrégation scolaire2 3, des violences policières racistes, ou des discriminations raciales systémiques sur le marché du travail4 5ou du logement6. L’objectif de cette vision politique de l’antiracisme est alors de remplacer l’idéologie raciste par une culture d’égalité et d’émancipation collective, d’entamer une transformation des structures sociales héritées du colonialisme pour repenser notre rapport au monde et réformer en profondeur nos institutions afin d’assurer une égalité effective dans l’accès aux droits fondamentaux. Cet antiracisme politique souligne aussi l’importance de la participation active des personnes non ciblées par le racisme dans la lutte antiraciste, en prenant conscience de leurs privilèges involontaires par rapport aux personnes qui se confrontent au racisme au quotidien, et en participant activement aux luttes pour l’égalité aux côtés de ces derniers.
Il est important de préciser que l’antiracisme moral et l’antiracisme politique ne sont pas nécessairement destinés à la confrontation, car ils peuvent coexister et se renforcer mutuellement, à condition de penser correctement la fonction spécifique de chacun et les termes de leur coexistence dans cette lutte d’émancipation collective.
- Comment s’est installé l’antiracisme moral et traditionnel en Belgique ?
La propagande coloniale des élites belges a joué un rôle fondamental dans la culture raciste et paternaliste encore active aujourd’hui dans notre société belge. Cette culture raciste imprègne la Belgique depuis plus de 140 ans. Dès les débuts de la colonisation belge en Afrique centrale (1876-1908) sous Léopold II et ensuite pendant le Congo belge (1908-1962), une intense propagande coloniale est menée pour obtenir et renforcer l’adhésion de la société belge aux ambitions mercantiles et coloniales de ses élites, en utilisant les théories raciales – très populaires en Europe à partir du XIXe siècle – pour justifier d’un côté la supposée supériorité de la civilisation blanche et chrétienne, et de l’autre l’animalisation, d’exotisation et l’infantilisation des “Noir·e·s”, – expliquant ainsi le bienfondé de la mission civilisatrice de la Belgique au Congo7. La presse écrite, la photographie, le cinéma, les livres (comme “Tintin au Congo”) et des événements populaires comme les folkores racistes des “Noirauds” de Bruxelles, de la “Sortie des nègres” de la Ducasse des Culants à Deux-Acren, du “Sauvage” d’Ath” ou l’Exposition universelle de 1897 avec son zoo humain à Tervuren (site qui deviendra en 1910 le musée, AfricaMuseum, que nous connaissons aujourd’hui8) ont été des puissants vecteurs du racisme dans toutes les couches de la population belge. Ce premier zoo humain de Tervuren a accueilli 7,8 millions de visiteurs, de Belgique et de de toute l’Europe.
Les zoos humains étaient des attractions plutôt populaires durant la période coloniale. Ceux-ci consistaient en la déportation et en l’exposition des personnes issues des colonies afin de recréer – du point du vue fantasmé des colons – des villages typiques d’un pays ou d’une “ethnie” dans le but de permettre aux classes populaires qui ne pouvaient pas voyager dans les colonies de voir ce qui s’y passait et ainsi adhérer à la mission civilisatrice de leur pays. En 1958, à l’Exposition universelle de Bruxelles, la Belgique a à nouveau déporté et exposé dans un zoo humain 278 Congolais·e·s, pour promouvoir les “réalisations” de la « Colonie modèle » belge. Cette expo 58 a accueilli près de 42 millions de visiteurs. Ces attractions n’ont pas pris fin après les décolonisations. Ainsi, plus proche de nous, la petite commune d’Yvoir (région de Namur) a organisé, en 2002, le dernier zoo humain connu en Belgique, dans son parc animalier avec des Bakas du Cameroun – reconstitution de village et mise en scène de leur mode de vie9. Nous devons ainsi prendre toute la mesure de l’impact sociétal dans la durée de la propagande coloniale et d’évènements populaires comme les zoos humains101112, qui ont eu une forte influence sur la représentation des personnes catégorisées comme noires encore aujourd‘hui mais aussi sur la manière de concevoir l’antiracisme en Belgique – en l’occurrence, la vision paternaliste et ”civilisatrice” dans la relation de la société belge avec les “Noir·e·s”, et par extension avec les ”non-Blanc·he·s”. Malgré sa présence et sa colonisation en Afrique centrale pendant plus de 77 ans (1885 – 1962), la composition démographique de la Belgique est restée pendant très longtemps relativement homogène13. Il n’était pas permis aux colonisé·e·s de s’installer en métropole, contrairement à d’autres régimes coloniaux comme la Grande-Bretagne. Une présence significative des colonisé.e.s en Belgique aurait pu être un danger pour le régime colonial, pour au moins deux raisons. D’une part, elle aurait pu menacer le pouvoir de la bourgeoisie belge, en permettant de possibles coalitions entre les couches les plus exploitées de la classe ouvrière belge et les colonisé.e.s vivant en métropole. Cela aurait été particulièrement explosif avec des mouvements d’aller-retour entre la métropole et les colonies, avec des colonisé·e·s dont la croyance en leur propre infériorité ainsi que dans le mythe de la suprématie blanche était significativement affaiblie. Cela aurait précipité des insurrections anticoloniales au Congo, au Rwanda et au Burundi. D’autre part, le régime colonial craignait que l’arrivée de Congolais·e·s, Rwandais·e·s et Burundais·e·s ne contredise, dans la pratique, les fondements raciaux du régime colonial via des éventuelles naissances d’enfants métis visibles dans l’espace public14 15. Pour éviter ce ”mélange racial”1617 (Demart, 2018), il aurait alors fallu mettre en place un coûteux régime d‘apartheid en métropole, similaire à celui mis en place au Congo pendant toute la période coloniale. Pour toutes ces raisons,il a fallu plus d’un siècle après le début de la colonisation pour qu’un mouvement questionnant le racisme en Belgique puisse voir le jour, d’abord en réponse au nazisme et à la seconde guerre mondiale, ensuite sous l’impulsion d’acteur·trice·s sociaux·ales directement concerné·e·s, issu.e.s pour l’essentiel des trajectoires migratoires des soixante dernières années.
Ensuite, le camp progressiste – composé des organisations de la classe ouvrière mais aussi plus tard du dense tissu associatif belge – s’est historiquement constitué depuis la fin du XIXe siècle autour des luttes domestiques pour la redistribution des richesses et la conquête des droits démocratiques, au détriment d’autres enjeux – comme la lutte anticoloniale. Cela a produit des effets durables jusqu’à aujourd’hui, notamment dans les difficultés actuelles du mouvement social belge à intégrer pleinement et à articuler les luttes antiracistes aux autres combats d’émancipation, au même niveau d’importance et de légitimité. Le mouvement social en Belgique a souvent circonscrit dans la pratique ses luttes à l’intérieur des frontières nationales et raciales. Il s’agissait par exemple pour les syndicats de défendre les droits des travailleur·euse·s belges opérant dans les colonies alors que dans le même temps, les colonisé·e·s n’avaient aucuns droits socio-économiques ni politiques- comme le droit de vote ou le droit de se syndiquer. La syndicalisation ainsi que les droits politiques des Congolais ne faisaient alors pas partie des mandats officiels des sections coloniales des syndicats belges.
Malgré sa profession de foi en une humanité commune et en l’égalité des droits, le camp progressiste belge a été en réalité assez indifférent à la question coloniale, sauf lors d’épisodes particulièrement sanglants comme la répression brutale de l’insurrection des Pendés en 1932 dans les plantations d’huile de palme de l’entreprise Palmolive18, ou lors du scandale international des mains coupées dans les plantations de caoutchouc19. En effet, en 1896, face aux atrocités commises sous les ordres de Léopold II pour augmenter la production de caoutchouc20, le POB ainsi que certains libéraux ont fortement dénoncé ces ”excès“ et ces atrocités et promu une colonisation ”moins brutale” et ”plus humaine”. Cependant, pour ce camp progressiste il ne s’agissait aucunement de toucher aux fondamentaux du système colonial, à savoir le pillage des ressources naturelles, l’exploitation économique des peuples habitant le Congo, la domination politico-militaire belge ainsi que la perpétuation de la “mission civilisatrice” de la suprématie blanche21.
Par la suite, après la Seconde Guerre mondiale, ce paternalisme d’origine coloniale s’est couplé d’une dimension universaliste et “colorblind”22. Il s’agissait d’affirmer le refus du racisme biologique, l’universalité de la race humaine, la lutte contre les préjugés raciaux et religieux et pour l’égalité des droits. En Belgique, en 1950, ce sont précisément des anciens résistants Juifs – la plupart communistes – qui vont lancer l’Union des Juifs contre le Racisme, l’Antisémitisme et pour la Paix, qui deviendra, en 1966, le MRAX 23. Il s’agit ici de la première organisation antiraciste de Belgique, portée à sa fondation par des personnes issues du principal groupe européen ciblé par le racisme depuis des siècles.
La force de l’antiracisme moral en Belgique s’explique enfin par les mécanismes systémiques du racisme qui empêchent les groupes ciblés par le racisme d’accéder pleinement à la parole publique et à la représentation politique. Il manque encore en Belgique un mouvement antiraciste autonome porté par ces groupes, et leur présence dans les institutions publiques, dans les lieux de production d’expertises et les postes de décision est encore trop faible. Cette situation est due aux discriminations raciales, parfois inconscientes, qui excluent les personnes racialement minorisées de ces espaces, et ce dès le système éducatif de base. La ségrégation scolaire en Belgique assigne souvent les enfants d’immigré·e·s dans des écoles de moindre qualité, avec des taux de décrochage élevés24 25 26. En 2024, l’OCDE27 classe ainsi la Belgique 28ième sur 38 pays membres pour les inégalités scolaires au niveau de l’enseignement secondaire, inégalités qui commencent en réalité dès l’école primaire. Outre ses dimensions socio-économiques, des études quantitatives montrent que ces inégalités ont en plus, une forte dimension raciale venant les renforcer28.
Ces inégalités se répercutent dans l’enseignement supérieur29 et le marché du travail, où les personnes issues de groupes ciblés par le racisme, sont surreprésentées dans le bas de la hiérarchie des salaires, des qualifications et des responsabilités ; et quasi absentes dans les postes de coordination et de décision. Une enquête de 2017 de la Fondation Roi Baudouin30 montre par exemple que les personnes afrodescendantes – majoritairement celles originaires du Congo, du Rwanda et du Burundi- sont quatre fois plus nombreuses au chômage, malgré un taux de diplômé.e.s de l’enseignement supérieur qui est quasi le double de la moyenne nationale. Vivant à 80 % des discriminations raciales, elles vivent très souvent aussi une situation de sous-qualification professionnelle, occupant donc des postes en dessous de leurs qualifications.
La société civile belge, y compris les associations antiracistes31, n’échappe pas au racisme systémique et ses logiques de discriminations. Les personnes dites ”non blanches” restent sous-représentées dans ce secteur, surtout dans les organes de décision, dans les mandats de représentation ou dans le porte-parolat32. En Belgique francophone mais aussi en Flandre, le secteur antiraciste traditionnel ou de la coopération au développement reste encore majoritairement composé de personnes ne vivant pas directement les effets négatifs du racisme et qui en ont souvent un rapport assez théorique, ce qui influence la manière dont les enjeux du racisme sont abordés et priorisés dans le débat public et les politiques d’égalité mises en place.
Déconnecté des racines coloniales du racisme belge et formulé sans les victimes du colonialisme d’hier ni des discriminations raciales d’aujourd’hui, cet antiracisme moral et universaliste répondait néanmoins légitimement au racisme biologique des nazis en prônant l’universalité de la condition humaine, la tolérance, la paix et l’égalité des droits. Cependant, ce cadre antiraciste, tout en étant justifié idéologiquement, a gardé ces caractéristiques car il ignore la ségrégation raciale et l’exploitation coloniale de la Belgique au Congo, au Rwanda et au Burundi. Le poète Aimé Césaire a exprimé dans son célèbre “Discours sur le colonialisme”33 , comment la tolérance envers l’oppression coloniale avec sa déshumanisation et ses crimes de masse, participe d’une morale à géométrie variable quand dans le même temps on s’insurge contre le nazisme ; alors que la première n’est que l’inspiratrice et la sœur du second. La seule différence étant que le régime nazi a pratiqué ses horreurs en Europe. Enfin, l’antiracisme traditionnel a pris pendant de longues décennies une posture individualisant les actes et propos racistes, et une attitude fort paternaliste envers les différentes immigrations post-coloniales. Cette vision a longuement dominé l’analyse du racisme et de l’antiracisme et reste encore influente aujourd’hui.
- Comment les cinq dernières années ont contribué aux mutations déjà en cours dans l’antiracisme belge ?
Néanmoins, depuis plus de trente ans, l’antiracisme en Belgique évolue progressivement grâce à l’arrivée dans l’espace public et associatif des enfants et petits-enfants des immigrés du Maroc, de Turquie et des pays anciennement colonisés par la Belgique – ainsi que des Belges afrodescendants plus généralement. Ces nouveaux acteur·trice·s, directement ciblés par les racismes systémiques d’aujourd’hui, ont parfois été perçus comme radicaux ou illégitimes par la société civile installée, qui a souvent ignoré leur existence ou entretenu avec eux des rapports mêlant méfiance, instrumentalisation et paternalisme.
Un exemple de cette mutation idéologique de l’antiracisme est la séquence 2019 – 2020, qui a été charnière dans l’histoire de l’antiracisme en Belgique. La manifestation Black Lives Matter (BLM)du 7 juin 2020 à Bruxelles, avec plus de 10 000 manifestant·e·s, en pleines restrictions sanitaires du COVID, reste à ce jour la plus grande manifestation antiraciste de l’histoire de la Belgique. Organisée par des militant·e·s Noir·e·s, pour la plupart actif·ve·s en dehors des réseaux antiracistes traditionnels, cette manifestation a rassemblé un public très diversifié, et majoritairement jeune. Il était alors palpable que quelque chose de nouveau était en train de se passer. Assez vite, les mobilisations BLM, à Bruxelles et ailleurs, ont en effet élargi le débat, passant de l’émotion entourant le meurtre de George Floyd aux États-Unis à la dénonciation des violences policières en Belgique et au racisme systémique, tout en faisant le lien avec le passé colonial et en exigeant l’ouverture de cette conversation encore taboue dans l’espace public – en dehors des milieux militants.
La formulation de ces revendications aurait sans doute été impossible sans la décennie précédente de mobilisation, de conscientisation et de plaidoyer des collectifs décoloniaux afrodescendants, sur l’importance de la discussion sur le passé colonial et ses crimes dans les enjeux de citoyenneté inclusive, d’égalité des droits et sur le lien entre colonialisme belge et racisme systémique – notamment négrophobe. Cet approfondissement de l’analyse sur le racisme, ce tournant décolonial, propose ainsi de comprendre l’histoire coloniale belge pour pleinement saisir les racines historiques et le fonctionnement actuel du racisme systémique belge, et d’ouvrir enfin la discussion sociétale sur la vérité et la justice pour les crimes coloniaux.
Cette évolution significative de l’antiracisme est portée, dès le début des années 2010, par des jeunes afrodescendant·e·s – notamment d’origine Congolaise, Rwandaise et Burundaise – vivant au quotidien la négrophobie systémique34, et portant la mémoire de l’oppression coloniale subie par les parents ou grands-parents ; également les difficultés d’intégration et les humiliations de la première génération après leur installation en Belgique à partir du milieu des années 1980 – en termes, entre autres, de refus de reconnaissance des diplômes et d’accès aux papiers, de précarité, des stigmatisations et discriminations racistes. 35
Ces militant·e·s antiracistes s’engagent ainsi dans le combat contre les violences policières, les discriminations raciales au travail et au logement ou l’invisibilisation des crimes coloniaux et la glorification des dignitaires de ce régime à travers, entre autres, l’espace public (statuts, rues, arrêts de bus, etc.). Des organisations comme le Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations 36, Change asbl, ou Bamko-Cran vont ainsi lutter pendant des années pour l’installation d’une place rendant hommage à Patrice Lumumba – leader panafricaniste de l’indépendance du Congo, humaniste et militant des droits humains – assassiné par la Belgique et les USA en janvier 196137; pour la restitution des biens culturels pillés pendant la colonisation ainsi que des restes humains des ancêtres séquestrés et exposés au sein de différentes institutions publiques de recherche et dans des collections privées ou la lutte entourant la rénovation du musée de Tervuren (2013-2018) et sa fonction historique d’imprégnation de la négrophobie et du récit colonial dans la société belge. D’autres organisations plus récentes comme le Collectif SUSU, le Collectif afroféministe belge Mwanamke, la Caravane Pour la Paix et la Solidarité Asbl continuent d’enrichir ce réseau associatif afrodescendant, avec notamment le courant décolonial afroféministe. Sur le terrain du mouvement étudiant, nous pouvons citer par exemple le Binabi – Centre culturel africain de l‘ULB. Dans la lutte pour les droits sociaux, la Voix des Sans-Papiers. Le travail pour la décolonisation de l’espace public et la mémoire des soldats Congolais enrôlés de force par la Belgique dans les guerres mondiales est encore assuré aujourd’hui par Bakushinta. Enfin, nous pouvons citer Mwinda Kitoko et Job Ubuntu qui travaillent autour du coaching et de l’insertion socio-professionnelle pour les Belges afro-descendant.e.s, et font également partie du ”Forum des minorités” en Flandre.
Bien que l’antiracisme en Belgique évolue progressivement vers un antiracisme politique avec, entre autres, l’intégration récente d’une perspective décoloniale, l’antiracisme moral reste encore majoritaire dans la plupart des espaces décisionnels dans le monde politique et culturel ainsi que dans la société civile.
Ces cinq dernières années, des tentatives louables d’intégration de l’antiracisme politique et décolonial ont eu lieu mais souvent de manière inégale et douloureuse, avec de nombreuses résistances à la clé. Au regard de ces enjeux, BePax mène une réflexion depuis ces dernières années sur son histoire, afin de pleinement contribuer à une lutte antiraciste politique et décoloniale en faveur de l’égalité et de l’émancipation pour tou·te·s. En effet, il ne suffit pas de déconstruire ses stéréotypes à un niveau individuel pour changer le statu quo. Par défaut, l’influence historique des rapports entre différents groupes sociaux est bien ancrée dans nos fonctionnements quotidiens. Il s’agit d’adopter une posture, un effort conscient, qui permettent de mieux percevoir les dynamiques de pouvoir qui opèrent dans notre environnement, de manière involontaire également. Indépendamment de nos éventuels préjugés. Le travail à mener est conséquent et ne peut se faire sans inclure et valoriser les savoirs des groupes ciblés par le racisme, qui luttent au quotidien à son encontre.
Antiracisme décolonial : avancées institutionnelles en demi-teinte
Les mobilisations Black Lives Matter de 2020 et le tournant décolonial de la lutte antiraciste ont ouvert une fenêtre d’opportunités institutionnelles en Belgique. Après des décennies de tabou et d’indifférence face au passé colonial belge et ses conséquences en termes de racisme systémique, plusieurs avancées notables ont eu lieu.
Au niveau fédéral, le Roi Philippe a exprimé des « regrets profonds » pour les crimes de la colonisation belge au Congo, au Rwanda et au Burundi, lors des 60 ans d’indépendance de la RDC en 2020. Sa tante, la princesse Esmeralda, a également appelé au déboulonnement des statues de Léopold II. Une commission spéciale sur le passé colonial a été mise en place au parlement fédéral, bien que ses travaux n’aient pas abouti à des excuses officielles en raison de pressions politiques et économiques. En parallèle, une loi fédérale a été votée pour encadrer la restitution des biens culturels volés et des restes humains. En 2023, une loi sur les discriminations cumulées et intersectionnelles a été adoptée. Depuis 2021, la DGD a intégré le thème « diversité et décolonisation » dans ses plans quinquennaux. Le secrétariat d’État fédéral à l’égalité des chances a été renommé pour inclure la diversité.
À Bruxelles, un plan régional pour la décolonisation de l’espace public a été élaboré, incluant les diasporas congolaises, rwandaises et burundaises. Les Assises de l’antiracisme ont eu lieu entre 2021 et 2022, suivies de la création début 2024 du Conseil consultatif bruxellois pour l’élimination du racisme. Ce contexte a permis de mettre en place trois plans régionaux de lutte contre le racisme : à Bruxelles, en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Cette dernière va par ailleurs rendre obligatoire l’enseignement de l’histoire coloniale belge dans les programmes scolaires – de la fin primaire et début secondaire – à partir de la prochaine rentrée. Après avoir été déboutées par le tribunal de première instance de Bruxelles en 2021, cinq femmes viennent de faire condamner l’Etat belge le 02 décembre 2024 pour crimes contre l’humanité. Une première historique qui ouvre potentiellement la voie à une nouvelle phase dans le travail de reconnaissance, de vérité et de justice par rapport à l’ensemble des crimes coloniaux belges commis en Afrique centrale. Il s’agit de cinq femmes, comme de milliers d’autres enfants métis38, qui ont été arrachées à leur famille par l’Etat colonial belge au Congo et confiées aux couvents de l’Eglise catholique. Le but était d’empêcher que l’existence publique de ces enfants ne perturbe et ne délégitime la suprématie blanche, son racisme biologique et l’ordre colonial qu‘ils justifient. Il fallait cacher ces ”enfants du péché”, comme les appelaient les institutions religieuses belges au Congo, au Rwanda et au Burundi.
Conclusion
Dans la suite de ses précédentes mutations du début des années 1990 et du milieu des années 2000 39, l’antiracisme belge a donc été traversé par de nouveaux changements ces cinq dernières années. Comme pour les précédentes transformations, nous avons assisté, dans la foulée des mobilisations BLM de 2020, à un renforcement de la parole des organisations portées par un des groupes ciblés par le racisme en Belgique – en l’occurrence, les Belges afrodescendant.e.s. Ces derniers ont permis une plus grande légitimité autant au débat crucial entourant les différentes dimensions de la décolonisation de la Belgique et des crimes coloniaux belges en Afrique centrale, que de l’articulation entre racisme systémique – notamment anti-Noir – et passé colonial de la Belgique.
Ces années ont été riches et ont permis, bien que de manière inégale, plusieurs changements qu’il convient de noter et de méditer pour la suite du combat antiraciste.
Les évolutions institutionnelles développées plus haut, bien que louables, demeurent assez limitées face à l’ampleur des enjeux de reconnaissance et de justice pour les crimes coloniaux, de lutte effective contre le racisme systémique et des réparations. Au cours des prochaines années, nous souhaitons surmonter les nombreuses résistances constatées auparavant. Les élections législatives et régionales de 2024 semblent indiquer une possible fermeture de cette fenêtre d’opportunités que nous travaillons à ouvrir à nouveau.
Quant à la société civile, notamment antiraciste, interculturelle et de coopération au développement, elle a tenté de revisiter son antiracisme, d’interroger ses pratiques face au racisme systémique et de réfléchir à l’intégration de la question décoloniale et du passé colonial belge dans ses missions. Nous saluons les efforts pour poursuivre et développer des formations sur la gestion des micro-agressions racistes, la lutte contre les discriminations et l’histoire coloniale de la Belgique, mobilisant au-delà des cercles militants classiques. Il s’agit d’un vrai défi de réaliser ce travail avec des personnes qui ne sont pas ciblées par le racisme et qui débutent leurs réflexions à ce propos, tout en préservant un cadre sécurisant pour les personnes qui vivent les effets du racisme au quotidien. BePax souhaite continuer à développer les savoirs et améliorer ses processus dans la pratique à ce niveau.
Bien que la dualité entre le réseau antiraciste traditionnel et les organisations des communautés issues de groupes ciblés par le racisme persiste, le tournant décolonial des cinq dernières années a permis de donner plus de place aux structures afrodescendantes. Leur inclusion dans des espaces de travail et de concertation, comme les auditions à la commission fédérale sur le passé colonial belge (2021-2022) et les assises contre le racisme au parlement bruxellois (2021), ou le Conseil consultatif bruxellois pour l’élimination du racisme (2024), marque une évolution notable, même si d’autres collectifs restent invisibilisés au sein de ces espaces40. Nous appelons à ce que les autorités publiques assurent enfin un soutien structurel – notamment en termes de subsides – envers ces organisations et garantissent leur pleine participation à l’élaboration des politiques publiques antiracistes, en dehors de consultations ponctuelles.
Le gain en légitimité de l’antiracisme politique et les questionnements sur une nouvelle approche antiraciste dans la société civile traditionnelle ne garantissent pas encore en elles-mêmes des développements positifs pour les prochaines années. Il est important de continuer à explorer collectivement, dans des relations matures de pleine égalité entre société civile traditionnelle et organisations des groupes ciblés par le racisme, des nouvelles approches pour l’élimination du racisme systémique, l’égalité réelle entre tou.te.s et la conquête d’une nouvelle citoyenneté pleinement décoloniale et inclusive.
Auteur : Christian Lukenge, chargé de plaidoyer chez BePax.
—————————————–
Notes de bas de page
1 Antiracisme : la roue tourne – BRUXELLES
2 Danhier, J., Jacobs, D., Martin, E., Alarcon-Henriquez, A., Vers des écoles de qualité pour tous ? Analyse des résultats à l’enquête PISA 2012 en Flandre et en Fédération Wallonie-Bruxelles, 2014, GERME – Institut de Sociologie, Université libre de Bruxelles.
3 Unia, Baromètre de la diversité : Enseignement, 2018, https://www.unia.be/fr/connaissances-recommandations/barometre-diversite-enseignement-2018.
5 Unia Baromètre de la diversité : emploi, 2012, https://www.unia.be/fr/connaissances-recommandations/barometre-de-la-diversite-emploi.
6 Unia, Baromètre de la diversité : logement, 2014, https://www.unia.be/fr/connaissances-recommandations/barometre-diversite-logement-2014 .
8 https://www.africamuseum.be/fr/about_us/history_renovation
9 Un village pygmée exposé dans un parc animalier belge – Libération
10 Les « zoos humains », vecteurs du racisme, au coeur d’une exposition en Belgique
11 Blanchard, Pascal, and Maarten Couttenier. “Les Zoos Humains.” Nouvelles Études Francophones, vol. 32, no. 1, 2017, pp. 109–15. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/44684570. Accessed 22 Nov. 2024.
12 Le zoo humain de Tervuren (1897) | Musée royal de l’Afrique centrale – Tervuren – Belgique
14 Jérémiah Vervoort, « La Belgique face à son passé colonial : l’affaire des enfants métis et la qualification de crime contre l’humanité », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 23 | 2023, mis en ligne le 06 février 2023, consulté le 25 novembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/revdh/17004 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.17004
16 Demart S. (2018) « L’épuisement des dynamiques de fédération des associations afrodescendantes :de la reconnaissance d’un sujet politique », Analyse n° 31, Edt. Kwandika de Bamko-‐ Cran asbl, Bruxelles
17 Etude de la migration congolaise (Centre) | EMN
18 Les « mains coupées » du Congo, une horreur de la colonisation
19 Isidore Ndaywel è Nziem, Histoire générale du Congo : de l’héritage ancien à la République démocratique, Paris, Bruxelles, De Boeck et Larcier, 1998, p. 360
20 M. Wiltz, « Il pleut des mains sur le Congo », Editions Magellan et Cie, Paris, 2015
21 La suprématie blanche est une idéologie fondée sur la croyance d’une supériorité des personnes blanches à d’autres catégories de la population.
22 En français, être aveugle à la race, le colorblindness designe le fait de ne pas porter attention à la (prétendue) race ou aux couleurs de peau comme stratégie de lutte contre le racisme. Cela a pour conséquence principale de minimiser les inégalités qui découlent du racisme.
25 Quand le marché scolaire produit ségrégation et inégalité
26 Pour aller plus loin sur le racisme en milieu scolaire, consultez l’outil pédagogique de BePax : Fariha Ali et Solange Umuhoza, Racisme en milieu scolaire : Outil d’animation pour questionner à l’école et au-delà, 2024.
27 OECD (2024), Education at a Glance 2024: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/c00cad36-en.
28 Danhier, J., Jacobs, D., Martin, E., Alarcon, A., Vers des écoles de qualité pour tous ?Analyse des résultats à l’enquête PISA 2012 en Flandre et en Fédération Wallonie-Bruxelles, 2014, GERME – Institut de Sociologie, Université libre de Bruxelles.
29 Indicateurs
31 Monitoring socio-économique 2022 | Unia
32 Inclure les personnes d’origine étrangère à l’emploi en Wallonie Bruxelles : quel bilan ? – IRFAM
33 Césaire, A. (1950). Discours sur le colonialisme. Paris : Présence Africaine.
34 Alors que seulement 33% des Belges possèdent un diplôme d’enseignement supérieur, les Afrodescendant.e.s sont à 60% à avoir ce niveau d’éducation mais ils connaissent pourtant un taux de chômage quatre fois supérieur à la moyenne nationale, et 56% sont en situation de sous-qualification, c’est à dire qu’iels occupent un emploi en-dessous de leur niveau d’études. De manière générale, 80 % des Afrodescendant.e.s en Belgique disent vivre des discriminations racistes.
Source : étude de 2017 commanditée par la Fondation Roi Baudouin et effectuée par des chercheur.euse.s de l’UCL, de l’ULG et de la VUB. Belges et Afro-descendants : discriminés | UCLouvain
35 03-Histoire-de-limmigration.pdf
36 En parallèle et à travers les mutations et les crises que traversaient le MRAX, des acteurs associatifs panafricains présents dans le Comité de Pilotage des Assises de l’Interculturalité en 2010 vont faire germer l’idée de ce type de collectif – jusque-là inexistant en Belgique – et vont fonder formellement en 2012 le Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations. A travers l’introduction de la mémoire du passé colonial belge dans le débat public, il s’agit de visibiliser et lutter contre la négrophobie.
Source : A propos – Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations
37 Square Lumumba : décoloniser les espaces et les esprits – Politique
39 Nadia Fadil & Marco Martiniello, « Racisme et antiracisme en Belgique », Fédéralisme Régionalisme [En ligne], Volume 20 : 2020, Trente ans de dynamiques fédérales et régionales,
URL : https://popups.uliege.be/1374-3864/index.php?id=2030
40 C’est par exemple le cas au sein du Conseil consultatif bruxellois pour l’élimination du racisme, dans lequel se trouve aucune organisation représentant la lutte contre l’islamophobie, alors qu’il y a une représentation des autres formes de racisme.